
Défi écrire chaque jour 12e jour- Dépasser un échec
Il est impossible de vivre sans échouer à quelque chose, à moins de vivre avec prudence, au point de ne pas avoir vécu du tout – dans ce cas, vous échouez par défaut
J.K. Rowling, discours lors de la cérémonie de remise des diplômes à l’Université de Harvard en 2008
Dans notre quête de succès et d’accomplissement, nous sommes inévitablement confrontés à des moments d’échec. Ces instants, souvent perçus comme des obstacles insurmontables, détiennent en réalité le pouvoir de devenir nos plus grands enseignants. Reconnaître, accepter, et surtout, se relever de ses échecs est une étape indispensable vers le bien-être mental et la croissance personnelle et professionnelle.
Chaque échec, chaque chute, nous confronte à nos limites, nos forces et nos possibilités i de rebond. Cet article se propose de dévoiler comment, loin d’être le point final de notre parcours, l’échec peut être un tremplin vers un aileurs.
Cet article se veut une invitation à observer nos échecs comme des étapes cruciales de notre développement. Il s’agit de changer notre perspective sur l’échec, de le voir comme une occasion de grandir, d’apprendre, et pourquoi pas, de réussir.
Pratiquons d’abord ensemble une écriture de l’échec avec cette consigne:
J’ai échoué et…
Voici mon texte
Avec une enfance et une adolescence marquées par l’échec scolaire, j’aurais pu dater mon premier échec dès la maternelle, lorsque j’ai demandé à mes parents d’arrêter d’ aller à l’école parce que la maîtresse était méchante. En effet, mes parents, quelque peu bohèmes, m’ont retiré de l’école. Et bien sûr, lorsque j’y suis retourné en CP, malgré quelques victoires (j’avais appris à écrire à la maison), la machine s’est embalée et j’ai de nouveau perdu la course. Retard, incompréhensions, passer ses journées à regarder par la fenêtre et à rêver d’être ailleurs…
Deux redoublements plus tard, j’entre enfin au lycée, où je commence à comprendre l’utilité de tout cela et à me projeter dans un avenir où l’école trouve enfin sens pour moi. L’échec était devenu une habitude mais c’était un échec auquel je ne donnais pas de valeur ; il ne me volait rien.
J’ai également échoué à mon concours d’entrée à l’école d’orthophonie, mais cela ne m’a pas affecté. J’ai déplacé ma réussite en m’inscrivant à l’université en psychologie. Ce parcours universitaire a éveillé en moi une passion et m’a détourné de mon idée première. Mes notes en psychologie étaient honorables, et je travaillais dur en neurobiologie et statistiques, des matières qui me posaient quelques difficultés. En maîtrise, je me suis penchée sur les troubles du comportement chez l’enfant sourd.
Ma directrice de recherche passa l’année à nier l’existence de ces troubles sans jamais me guider vers une autre manière de penser. C’était à l’époque la manière de nommer l’hyperactivité. Mon travail de recherche, fondé sur la psychanalyse, ne correspondait pas à ses attentes, ce que je compris bien plus tard. Premier échec. Un huit sur vingt vient sanctionner mon travail. On me conseille de redoubler pour pouvoir refaire un mémoire, alors que mes notes dans les autres matières sont excellentes. Ayant déjà vécu des redoublements, je refuse de le demander volontairement, considérant cela comme une injustice.
Coincée dans cet échec, je rejette le système : redoubler pour obtenir ce fameux quinze au mémoire qui, paraît-il, ouvre les portes de la dernière année de psychologie. Je résiste. Je ne veux pas avoir échoué. C’est l’idée d’un avenir qui s’effondre. Je commence par défier l’injustice et envoie mon mémoire à un enseignant spécialiste de la surdité sans mentionner ma note, pour avoir son avis. Il en pense beaucoup de bien.
À partir de là, je peux avancer, un peu comme lorsqu’on porte plainte, qu’un procès a lieu et que le juge offre une réparation symbolique. Je sais que je vais devoir lutter pour entrer en dernière année, que mon dossier ne sera pas retenu l’année suivante sans des expériences professionnelles pour compenser cette note. Pendant un an, je travaille en crèche, convaincue que l’observation du développement des jeunes enfants enrichira mon projet de travailler comme psychologue avec les enfants sourds. J’ajoute à cela une licence en sciences de l’éducation. Le tour est joué. J’ai déjoué le destin. Après un petit détour, je retrouve le chemin.
Mais que se passe-t-il quand ce chemin est définitivement barré ? C’est un deuil, sans aucun doute. Tristesse, colère, acceptation. Quel parcours ! J’ai vécu des deuils, notamment celui d’une carrière théâtrale. Le chemin n’a pas été barré par d’autres ; je l’ai moi-même transformé en impasse. Est-ce cela, l’échec ? Oui, sans doute. C’est aussi cela.
Ce que j’ai ressenti en écrivant :
Je n’ai pas été surprise de parler de cet échec, même si je ne l’avais pas prémédité. Il s’est imposé sous ma plume comme une évidence, car pour la première fois, d’autres que moi brisaient un rêve. À la fin du texte, je fus surprise de souligner certains échecs, peut-être les plus douloureux, ceux que l’on s’inflige à soi-même par des pensées limitantes. Car on peut se relever d’un échec, mais pas toujours de l’idée que l’on s’en fait, de ce qu’il révèle sur nous. « Je ne mérite pas, je n’ai pas de talent, je suis trop ceci, pas assez cela. »
Cette histoire, je l’ai tant racontée lorsqu’elle m’est arrivée, comme pour accuser. C’étaient les autres. On m’avait fait du mal. On décidait de ma vie. Mais l’écrire plus de trente ans plus tard n’a pas la même saveur. Écrire sur ses échecs, sur nos réactions, nos ressentis, sur cet après-coup dans lequel nous nous trouvons, qui nous permet d’analyser l’impact de l’échec, me semble être une démarche riche et instructive.
Dans le roman « Numéro Deux » de David Foekinos., c’est précisément une des solutions tentées par le personnage : écrire son histoire, donner un sens à l’échec dans le récit d’une vie. Voilà une démarche qui nous semble instinctivement thérapeutique. À vos plumes, les amis.

En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d’acteurs furent auditionnés. Finalement, il n’en resta plus que deux. Ce roman raconte l’histoire de celui qui n’a pas été choisi.
Comprendre l’échec
- Définition et perception de l’échec
L’échec, dans son sens le plus large, peut être perçu comme l’incapacité à atteindre un objectif fixé. Cette définition, pourtant simple en apparence, recèle une complexité profonde, car elle touche à la subjectivité de nos aspirations et de nos limites.
Ce qui constitue un échec pour une personne peut être considéré comme une étape vers le succès par une autre. Ainsi, l’échec n’est pas tant une destination finale qu’un point de passage dans nos vies.
La manière dont nous percevons l’échec a un impact considérable sur notre capacité à avancer. Si nous le voyons comme une fin en soi, un jugement irrévocable sur nos compétences ou notre valeur, l’échec peut devenir un poids qui freine notre progression. Cette perception négative peut entraîner peur, découragement, et une réticence à prendre des risques ou à poursuivre nos objectifs, nous enfermant ainsi dans un cycle d’inaction et de regret.
Il est souvent conseillé de voir l’échec comme une source d’apprentissage et de développement. Les leçons tirées des échecs sont souvent plus précieuses que celles apprises dans le succès, car elles nous confrontent à nos limites, nous incitent à la réflexion et à l’autoévaluation, et nous poussent à développer de nouvelles stratégies pour surmonter les obstacles.
Transformer notre perception de l’échec demande du temps et de la pratique. Cela commence par la déstigmatisation de l’échec lui-même : le reconnaître non pas comme un tabou ou une honte, mais comme un aspect inévitable et enrichissant du parcours humain.
- Les différents types d’échecs :
L’échec se manifeste sous plusieurs formes dans notre vie. Comprendre la variété des échecs peut nous aider à mieux saisir leur impact sur notre psychologie et la manière dont nous pouvons les surmonter.
- Échecs personnels
Les échecs personnels sont ceux qui touchent à nos relations, à notre bien-être personnel, ou à nos objectifs de vie personnels. Il peut s’agir de la fin d’une relation importante, d’un projet personnel non abouti, ou d’une tentative de changement de mode de vie qui n’a pas porté ses fruits.
Ces échecs peuvent être particulièrement douloureux car ils touchent à l’intime, à ce que nous sommes au plus profond de nous. Ils remettent souvent en question notre perception de nous-mêmes et de notre place dans le monde.
- Échecs professionnels
Les échecs professionnels surviennent dans le cadre de notre carrière ou de nos affaires. Ils peuvent prendre la forme d’un projet échoué, d’une promotion non obtenue, ou d’une entreprise qui fait faillite. L’impact de ces échecs est souvent ressenti à la fois sur le plan financier et sur le plan de l’estime de soi, car notre identité est fréquemment liée à notre réussite professionnelle. La pression sociale pour réussir dans notre carrière peut rendre ces échecs particulièrement éprouvants.
- Échecs académiques
Les échecs académiques concernent nos expériences d’apprentissage et d’éducation. Ils peuvent se manifester par des notes décevantes, l’échec à l’obtention d’un diplôme, ou la difficulté à maîtriser un champ d’étude. Pour les étudiants et ceux qui sont dans des parcours éducatifs, ces échecs peuvent affecter leur vision de leur avenir et altérer leur confiance en leur capacité à apprendre et à réussir.
- Impact sur notre psychologie
L’impact psychologique de l’échec varie en fonction du type d’échec et de la signification que nous lui attribuons. En général, l’échec peut entraîner des sentiments de honte, de culpabilité, et de doute de soi.
Il peut éroder notre confiance et nous faire questionner notre valeur et nos compétences. Pourtant, l’échec a également le potentiel de favoriser la croissance personnelle. En nous confrontant à nos limites, il nous pousse à développer une meilleure connaissance de soi, à revoir nos stratégies, et à renforcer notre résilience.
Les conséquences de l’échec
Impact psychologique de l’échec :

- Sentiment d’incompétence
L’échec peut souvent être interprété comme un reflet de nos capacités. Ce sentiment d’incompétence surgit lorsque nous mettons en doute notre habileté à accomplir des tâches ou à atteindre des objectifs, se demandant si nos échecs passés ne prédisent pas notre incapacité à réussir à l’avenir.
Cette remise en question de nos compétences peut saper notre confiance et limiter notre volonté d’essayer de nouveau, de peur de répéter les mêmes erreurs.
- Sentiment de honte
La honte est une émotion puissante et profondément personnelle qui peut accompagner l’échec. Elle découle de la perception que notre échec n’est pas seulement un événement isolé, mais une exposition de nos défauts fondamentaux aux yeux des autres et de nous-même. Cette vulnérabilité peut entraîner un désir de se cacher, d’éviter les situations où l’on risque à nouveau l’échec, ou de se replier sur soi pour échapper au jugement, réel ou imaginé, des autres.
- Sentiment de découragement
L’échec peut également conduire à un sentiment profond de découragement, surtout si les efforts déployés ne semblent pas porter leurs fruits. Ce désarroi peut être exacerbé par des échecs répétés ou par la comparaison avec les réussites d’autrui, créant une spirale de négativité qui rend difficile la motivation à persévérer. Le découragement peut freiner notre élan vers la poursuite de nos objectifs, nous laissant avec un sentiment d’impuissance face à nos aspirations.
- Surmonter l’impact psychologique de l’échec
Reconnaître et accepter ces sentiments est la première étape pour les surmonter. Il est crucial de comprendre que l’échec, aussi douloureux soit-il, ne définit pas notre valeur ni notre capacité à réussir à l’avenir. Se rappeler nos succès passés, même mineurs, peut aider à restaurer la confiance en nos compétences. De plus, partager nos expériences d’échec avec des personnes de confiance peut alléger le poids de la honte et du découragement, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte.
Enfin, redéfinir notre perception de l’échec comme une étape nécessaire à l’apprentissage et à la croissance personnelle peut transformer notre approche. Plutôt que de voir l’échec comme un signe d’incompétence, il peut devenir un catalyseur pour le développement de la résilience, l’adaptation de nos stratégies et, ultimement, l’atteinte de nos objectifs.
L’échec comme opportunité de croissance :

Chaque échec porte en lui le potentiel de nous révéler nos limites, de stimuler notre créativité, et de renforcer notre résilience. Voici comment transformer l’échec en une occasion d’apprentissage et de croissance personnelle.
- Reconnaissance et acceptation
La transformation de l’échec en une opportunité commence par la reconnaissance et l’acceptation de l’échec lui-même. Reconnaître ses erreurs sans se laisser submerger par la culpabilité permet de prendre du recul et d’analyser la situation objectivement. Accepter l’échec comme partie intégrante du processus de réussite nous libère de la peur de l’échec, ouvrant la voie à un état d’esprit axé sur la croissance.
- Analyse et introspection
Une fois l’échec accepté, il devient crucial de l’analyser pour en tirer des leçons. Se demander « Qu’est-ce qui a mal tourné ? » et « Que puis-je faire différemment la prochaine fois ? » sont des questions qui aident à identifier les facteurs ayant mené à l’échec.
Cette introspection permet de découvrir des points aveugles dans nos compétences, notre planification ou notre exécution, et de tracer un plan d’action pour les adresser.
- Développement de la résilience
L’échec est un test de résilience, cette capacité à rebondir face aux adversités. Chaque échec surmonté renforce notre confiance en notre capacité à faire face à l’incertitude et aux difficultés.
- Innovation et créativité
L’échec nous pousse souvent à repenser nos approches et à innover. Face à un obstacle, la nécessité de trouver des solutions alternatives peut stimuler notre créativité et nous amener à explorer des voies que nous n’aurions pas considérées autrement. L’échec, en nous sortant de notre zone de confort, favorise ainsi l’innovation et la découverte de nouvelles possibilités.
Se relever à travers l’écriture
L’écriture, souvent perçue comme une forme d’expression artistique, est également un puissant outil de guérison et de résilience face à l’échec. Quand les mots coulent sur le papier, ils peuvent aider à transformer notre perception de l’échec, à le démystifier et à en extraire des leçons précieuses.
- Catharsis émotionnelle
L’un des premiers bienfaits de l’écriture est sa capacité à offrir une catharsis émotionnelle. Écrire sur nos échecs permet d’extérioriser les sentiments d’incompétence, de honte, et de découragement qui y sont souvent liés. Ce processus d’externalisation aide à clarifier nos pensées, à alléger notre charge émotionnelle et à commencer à voir nos expériences sous un nouveau jour.
- Mise en perspective et analyse
L’écriture nous encourage à articuler nos pensées, à réfléchir sur les causes et les conséquences de nos actions. En décrivant nos échecs, nous sommes invités à les analyser de manière constructive. Cette introspection peut révéler des fausses croyances, des patterns comportementaux, des décisions malheureuses, ou des lacunes dans notre préparation qui ont contribué à l’échec. Reconnaître ces éléments est le premier pas vers le changement et l’amélioration.
- Planification et objectivation
Écrire sur nos échecs nous permet de transformer des expériences négatives en plans d’action positifs. En identifiant les leçons apprises, nous pouvons esquisser des stratégies futures pour éviter les mêmes écueils. L’écriture devient alors un exercice de planification, nous aidant à objectiver nos expériences et à tracer un chemin vers le succès.
- Renforcement de la résilience
Se relever après un échec nécessite de la résilience, et l’écriture est une pratique qui renforce cette qualité. En nous confrontant à nos échecs par l’écriture, nous apprenons à les accepter comme des composantes de notre parcours. Cette acceptation forge en nous une résilience qui nous sera utile face aux défis futurs.
- Partage et connexion
L’écriture sur l’échec peut également créer des connexions profondes avec les autres. Partager nos histoires peut inspirer ceux qui traversent des périodes similaires de doute et de découragement. En lisant sur les épreuves et la résilience d’autrui, nous nous sentons moins seuls dans notre lutte, et nous pouvons puiser de l’espoir et de la motivation dans l’expérience partagée.
L’écriture, en somme, est une alliée précieuse dans le processus de se relever après un échec. Elle offre un espace pour traiter nos émotions, analyser nos expériences, planifier notre relèvement, et partager nos histoires de résilience. En transformant nos échecs en mots, nous pouvons finalement les transformer en sagesse, en force, et en inspiration pour l’avenir.
Cas pratiques et témoignages
Histoires inspirantes :
La route vers le succès est souvent pavée d’échecs, et de nombreuses personnalités illustres nous ont prouvé que ces obstacles ne sont pas insurmontables, mais plutôt des étapes cruciales du voyage. Voici des exemples marquants de personnes qui ont transformé leurs échecs en tremplins vers des réalisations exceptionnelles.
- J.K. Rowling
Avant de devenir l’auteure de la série à succès mondial « Harry Potter », J.K. Rowling a traversé une période sombre de sa vie, marquée par le chômage, un divorce difficile, et la lutte contre la dépression. Le manuscrit de « Harry Potter à l’école des sorciers » a été rejeté par douze maisons d’édition avant d’être finalement accepté par Bloomsbury. L’histoire de Rowling nous enseigne la valeur de la persévérance et de la foi en son propre potentiel, même dans les moments les plus sombres.
- Thomas Edison
Thomas Edison, l’un des inventeurs les plus prolifiques de l’histoire, a connu des milliers d’échecs dans sa quête pour créer l’ampoule électrique. À chaque échec, il disait : « Je n’ai pas échoué. J’ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » L’histoire d’Edison souligne l’importance de la persévérance et de l’optimisme, nous rappelant que chaque échec nous rapproche un peu plus de notre réussite.
- Steve Jobs
Steve Jobs, cofondateur d’Apple, a été évincé de l’entreprise qu’il avait aidé à créer. Cette période difficile l’a conduit à fonder NeXT et Pixar, avant de revenir à Apple en tant que CEO et de la mener à de nouveaux sommets. Jobs voyait son échec et son renvoi comme une opportunité de recommencer et de se réinventer. Sa trajectoire illustre comment un échec apparent peut ouvrir la porte à de nouvelles opportunités et à un succès encore plus grand.
Ces histoires montrent que derrière chaque réussite se cache souvent une série d’échecs. Elles nous rappellent que l’échec n’est pas le contraire du succès, mais plutôt une partie intégrante du processus menant à celui-ci. L’échec nous enseigne, nous teste, et nous prépare pour les succès à venir. En embrassant nos échecs et en apprenant d’eux, nous pouvons atteindre des sommets que nous n’aurions jamais imaginés.
- Témoignages de résilience :
Chacun de nous porte en lui des histoires d’échec et de résilience, des moments où, face à l’adversité, nous avons trouvé la force de nous relever et de continuer à avancer. Ces expériences, qu’elles soient grandes ou petites, façonnent notre caractère et tracent le chemin de notre développement personnel. En partageant ces récits, nous créons un espace de soutien et d’inspiration, rappelant à chacun qu’il n’est pas seul dans sa lutte.
Je vous invite, chers lecteurs, à partager avec nous ou dans le secret de votre carnet vos propres histoires d’échecs et de rebond. Qu’il s’agisse d’une perte d’emploi, d’un projet personnel non abouti, d’un objectif académique non atteint, ou de tout autre défi que vous avez surmonté, écrire votre histoire pourra vous éclairer et encourager d’autres personnes se trouvant peut-être dans une situation similaire.
- Quelle a été votre expérience avec l’échec et comment avez-vous trouvé la force de vous relever ?
- Quelles leçons avez-vous tirées de cette expérience ?
- Comment cet échec a-t-il contribué à votre croissance personnelle ou professionnelle
En savoir plus sur Psycho-Plume
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






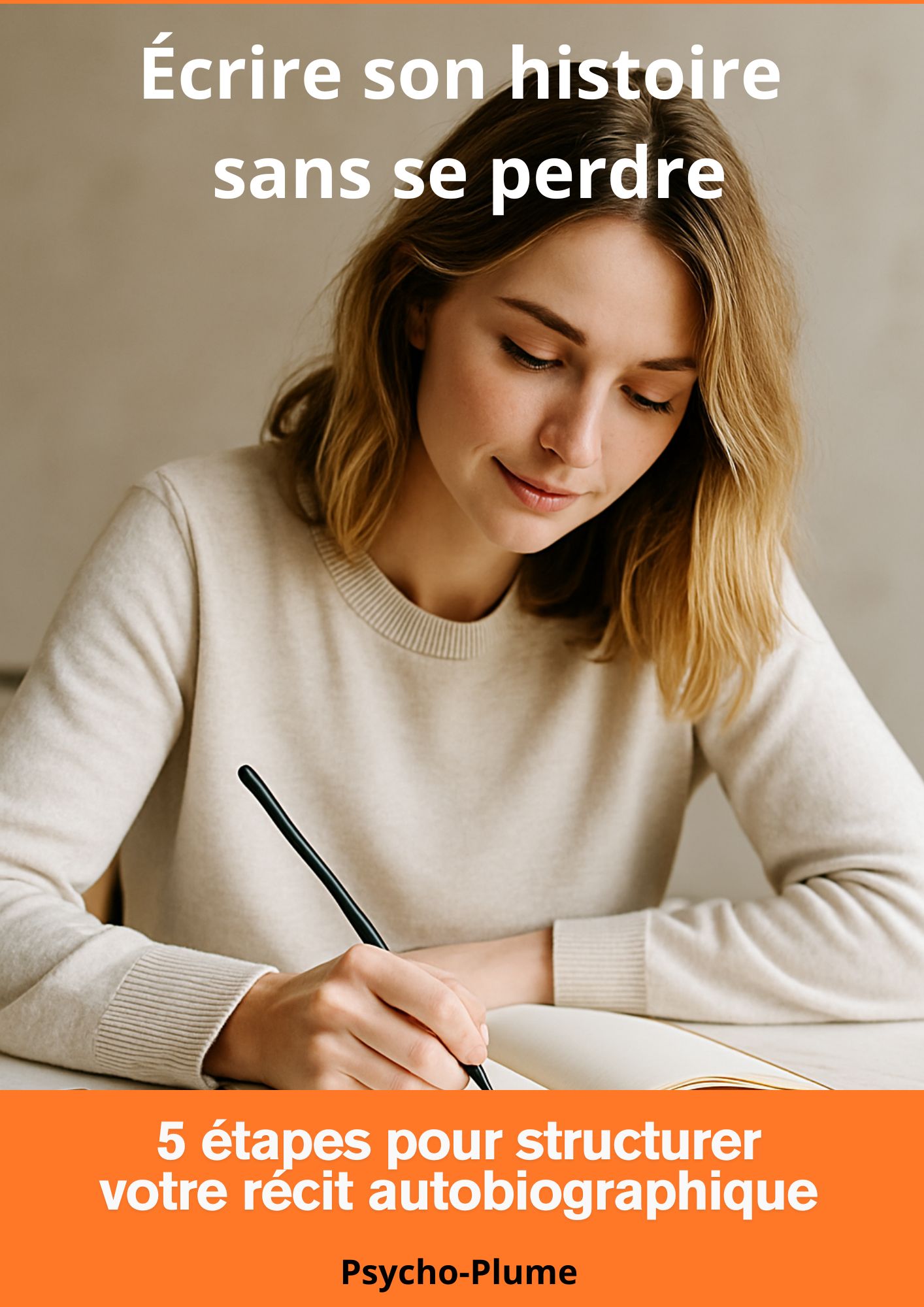
5 commentaires
DENIS
Merci pour cet article touchant qui m’a -évidemment- rappelé certains échecs que j’ai subis… et parfois que j’ai (hélas) infligés à autrui. Tu cites divers exemples de personnes qui se sont relevés de leur(s) échec(s). Malheureusement, d’autres ne parviennent pas à surmonter ce terrible « miroir » et en sont littéralement brisés.
Je dissocie donc les échecs perçus comme injustes et qui suscitent notre colère de ceux que nous intériorisons et qui dégradent l’image que nous avons de nous-mêmes. Ceux-là sont redoutables… et c’est là que tes conseils sont précieux. Merci !
Renan
Un article d’une grande importance pour comprendre qu’il faut accepter et apprendre de l’échec. L’exercice d’écriture thérapeutique proposé est un excellent moyen de traiter les émotions liées à l’échec et de le voir sous un jour nouveau. J’avais regardé un TedX et l’intervenant parlait de « sortir les poubelles mentales ». Dans tous les cas, écrire permet de mettre à plat ce qui se passe dans la tête. J’aime beaucoup le faire 🙂
Les exemples de J.K. Rowling, Thomas Edison, et Steve Jobs rappellent que derrière chaque succès, il y a souvent de nombreux échecs, soulignant que la clé est de continuer à avancer. Il faut simplement apprendre à faire preuve de résilience et regarder le passé non pas pour se flagéler mais pour grandir.
Anick
On ne se penche que rarement sur la valeur de l’échec. On lui préfère les objectifs, les projets,les résolutions… cet article nous rappelle l’importance de l’échec. J’ai bien aimé le concept de l’échec comme un palier vers la réussite et le succès. L’échec devient quelque chose de positif et d’utile pour grandir. Merci pour cette belle approche 😊🙏
Claire
Merci Olivia pour ce bel article sur un sujet qui reste encore tabou dans notre culture, l’échec !
J’adore la citation de JK Rowling et les exemples de parcours inspirants. On ne voit souvent que l’aboutissement final d’une réussite, et on oublie toutes les tentatives qu’il y a eu derrière… cela demande aussi du courage de s’ouvrir sur des choses qui n’ont pas fonctionné comme on voudrait. Avec l’entreprenariat, j’ai appris à mettre mon ego de côté et ne pas remettre en cause ma valeur personnel si un projet que je lance ne fonctionne pas ! J’essaye d’en tirer les leçons pour avancer.
Dieter
L’article offre une exploration inspirante de la manière dont nous pouvons transformer l’échec en un tremplin pour la croissance personnelle et professionnelle. En citant J.K. Rowling, qui a brillamment parlé de l’échec comme d’une étape inévitable vers le succès, cet article nous invite à changer notre perspective sur l’échec, le percevant non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme une opportunité d’apprendre et de grandir.
Ta réflexion personnelle sur tes propres expériences d’échec, depuis les difficultés scolaires jusqu’aux défis professionnels, sert d’exemple puissant et tangible de la façon dont les échecs peuvent devenir des leçons de vie précieuses. L’histoire de ton parcours académique et professionnel, marqué par des échecs initiaux et des redirections inattendues, illustre magnifiquement que l’échec n’est pas le point final, mais plutôt un moment de réflexion et de redirection vers de nouvelles possibilités.
L’approche de l’article, encourageant l’écriture thérapeutique comme moyen de traiter et de réfléchir sur l’échec, offre une méthode accessible et profondément personnelle pour faire face aux défis. L’exercice d’écriture proposé, « J’ai échoué et… », est une invitation à explorer nos sentiments les plus intimes et à les transformer en force et en résilience.
Les témoignages inspirants de figures telles que J.K. Rowling, Thomas Edison, et Steve Jobs, qui ont tous surmonté des échecs spectaculaires pour atteindre un succès extraordinaire, rappellent que l’échec est une composante universelle de l’expérience humaine. Ces histoires soulignent l’importance de la persévérance, de la résilience, et de la foi en nos propres capacités et potentiel.
Cet article est un rappel puissant que, bien que l’échec puisse être douloureux et décourageant, il détient également le pouvoir de nous enseigner, de nous façonner, et de nous préparer pour des réussites futures encore plus grandes. En acceptant l’échec comme une partie naturelle et enrichissante de notre parcours, nous pouvons embrasser pleinement la vie avec toutes ses complexités et ses beautés.
Merci pour ce partage sincère et motivant.