
Quand l’écriture résiste : que révèle ce blocage ?
Écrire semble simple : un stylo, une feuille, quelques minutes de silence. Pourtant, ceux qui pratiquent l’écriture de manière régulière savent que ce geste en apparence anodin se heurte parfois à une force invisible. On voudrait écrire, mais on ne peut pas. Le carnet reste fermé, les phrases s’interrompent, l’élan se brise. Cette expérience universelle porte un nom : la résistance.
La résistance à écrire n’est pas seulement une difficulté technique ou un manque d’inspiration. Elle dit quelque chose du rapport intime que chacun entretient avec ses propres mots. Elle révèle la peur de se confronter à soi, l’influence du regard imaginaire des autres, les traces laissées par l’histoire personnelle. Elle est le signe que l’écriture engage plus que l’intellect : elle convoque l’affect, l’inconscient, la mémoire.
Plutôt que de la réduire à un échec ou à une panne, il est plus fécond de la considérer comme un symptôme à écouter. La résistance n’est pas un obstacle extérieur : elle est une production psychique, un signal. S’y confronter, c’est accepter de se mettre à l’écoute de ce qui, en soi, cherche à être dit mais ne trouve pas encore la voie des mots.
Qu’appelle-t-on la “résistance” en écriture ?
Le terme de résistance est emprunté au vocabulaire psychanalytique : il désigne ces forces qui s’opposent à l’émergence d’un contenu inconscient. Dans l’écriture, la résistance se manifeste par une incapacité à passer à l’acte scriptural, malgré l’envie ou la nécessité d’écrire.
Deux types de résistances
- La résistance créative : elle appartient au processus normal de tout écrivain. Elle correspond aux moments de silence où le texte se prépare dans l’ombre. La page reste blanche parce que les idées doivent encore infuser. Ces résistances-là sont fécondes : elles permettent la maturation, elles évitent la précipitation.
- La résistance psychique : elle est d’une autre nature. Elle ne traduit pas une simple attente, mais une inhibition. Quelque chose en soi empêche le passage à l’écrit, comme si les mots menaçaient un équilibre fragile. Ici, la résistance ne nourrit pas la création, elle la bloque.
Exemples de manifestations
- Un carnet commencé et refermé brusquement.
- Des phrases raturées avant même d’avoir été lues.
- L’impression que les mots sont “juste là”, mais inaccessibles.
- La sensation de ne pas avoir “le droit” d’écrire certaines choses.
La résistance en écriture n’est donc pas homogène. Elle peut être passagère ou durable, liée à une circonstance ou enracinée dans une histoire profonde.
Les causes possibles de la résistance à écrire

La peur de soi
Écrire, c’est se mettre en contact avec son monde intérieur. Or, ce face-à-face peut effrayer. Derrière la résistance, il y a souvent la peur d’affronter une émotion trop vive, une mémoire douloureuse, une vérité refoulée. L’écriture devient menaçante parce qu’elle risque de lever le voile.
Une femme me racontait avoir arrêté son journal intime pendant plusieurs années, car chaque fois qu’elle ouvrait son cahier, ses larmes surgissaient. Elle redoutait que l’écriture n’ouvre une brèche irréversible. Sa résistance la protégeait d’un trop-plein.
On pense aussi à Proust : “Le souvenir d’une certaine image n’est que le regret d’un certain instant.” Écrire, c’est convoquer des instants, mais certains restent interdits. La résistance protège de leur retour.
Le poids du lecteur imaginaire
Nombreux sont ceux qui écrivent sous un regard imaginaire : celui d’un parent exigeant, d’un professeur critique, d’un lecteur idéalisé. Même seul face à sa feuille, on se sent observé. Ce lecteur fantasmé juge, censure, interdit. Alors, les mots s’arrêtent.
C’est ce que Winnicott appelait le “faux self” : cette part de soi qui s’ajuste au désir des autres, au détriment de sa vérité intérieure. L’écriture résistante porte la trace de ce conflit : écrire pour soi ou pour le regard de l’autre ?
Le contexte extérieur
Parfois, la résistance n’est pas psychique mais contextuelle. Le quotidien déborde, la fatigue empêche la disponibilité, les obligations saturent l’esprit. Écrire demande un minimum d’espace intérieur. Sans cet espace, la main se fige.
Il ne faut pas négliger cette dimension pragmatique : la résistance peut simplement signifier que le moment n’est pas propice. Le corps réclame du repos avant que la pensée puisse s’exprimer. Comme le disait Montaigne : “Mon esprit ne va pas toujours où je veux.”
Que révèle la résistance dans le travail psychique ?

Plutôt que de voir le blocage comme un obstacle, il est fécond de l’aborder comme un message. La résistance n’est pas vide : elle dit quelque chose.
La fonction protectrice du blocage
La résistance peut être comprise comme une défense. Elle protège contre une effraction psychique. Ne pas écrire, c’est parfois éviter de mettre en mots un contenu insupportable. Ce silence forcé n’est pas une faiblesse, mais une tentative de sauvegarde.
On retrouve ici la même logique que dans le rêve interrompu : l’inconscient censure pour ne pas laisser surgir une image trop violente. L’écriture résistante a cette fonction protectrice.
Le blocage comme signal d’un conflit interne
Souvent, la résistance témoigne d’un conflit : une partie de soi veut dire, une autre veut taire. Ce tiraillement se traduit dans le geste même d’écrire : les phrases commencent mais s’interrompent, l’élan surgit puis se fige.
La résistance matérialise cette lutte silencieuse. L’écouter, c’est reconnaître qu’on n’est pas unifié, qu’une division travaille en nous. Le blocage devient alors un lieu d’observation privilégié.
Les fausses solutions face à la résistance
Il est tentant de répondre à la résistance par des stratégies d’évitement ou de contrainte. Pourtant, ces “fausses solutions” ne font souvent que renforcer le blocage.
Se forcer à écrire coûte que coûte
Certains conseillent de remplir des pages, même vides de sens, pour dépasser le blocage. Mais l’injonction “il faut écrire” peut produire l’effet inverse : elle transforme l’écriture en devoir, réactivant la censure. La résistance s’en trouve accrue.
Se juger, se culpabiliser
Une autre fausse issue est l’autocritique : “Je n’ai aucune discipline. Je ne suis pas fait pour écrire.” Ce discours intérieur aggrave la honte et enferme dans le silence.
Éviter totalement l’écriture
À l’inverse, certains renoncent : “Puisque ça bloque, je n’écrirai plus.” Mais le désir ne disparaît pas. Il s’enfouit, générant frustration et perte de contact avec soi. La résistance, non travaillée, devient alors un silence définitif.
Autres formes de résistance

On pense spontanément à la page blanche, mais la résistance prend d’autres visages plus subtils. Elle se manifeste parfois non par un silence, mais par un excès.
Le bavardage qui masque
Certaines personnes écrivent beaucoup, mais sans jamais atteindre ce qu’elles voudraient vraiment dire. Le texte se déploie, prolifère, mais reste en surface. La résistance, ici, se cache derrière l’abondance : les mots servent à éviter l’essentiel.
On lit parfois des pages de journaux intimes qui semblent saturées de détails insignifiants. Derrière l’accumulation, une question brûlante demeure évitée. L’écriture se protège en détournant l’attention.
L’écriture compulsive
D’autres écrivent de manière compulsive, sans relâche, mais dans une forme de fuite en avant. Les mots s’alignent pour conjurer l’angoisse, sans véritable élaboration. Là encore, la résistance est présente : elle ne bloque pas, elle empêche d’approfondir.
L’effacement des traces
Enfin, certaines résistances s’expriment dans le geste d’effacer : raturer, déchirer, supprimer. L’acte d’écrire a lieu, mais il est aussitôt annulé. La peur de laisser une trace est plus forte que le désir de dire. Ce va-et-vient est une autre modalité du blocage : écrire pour aussitôt détruire.
Quand les écrivains racontent leur résistance
La résistance à écrire n’est pas propre aux anonymes : elle traverse aussi les plus grands.
Kafka
Kafka écrivait dans son journal :
« Inquiétude constante pour mon écriture : rien de ce que j’écris ne me satisfait, tout me paraît imparfait, inachevé. »(Journal, 1910-1911, trad. M. Robert).
« Tout ce que j’écris est mauvais, maladroit, partiel. » (Journal, 21 août 1913).
Son rapport à l’écriture était traversé de doute et de culpabilité. Ses fragments inachevés témoignent de cette lutte incessante avec la résistance.
Virginia Woolf
Dans ses carnets, Virginia Woolf décrit ses périodes de silence comme des moments douloureux mais nécessaires. Elle notait que l’écriture ne venait pas toujours, et qu’il fallait accepter ces creux comme des phases de respiration de la pensée.
Perec
Georges Perec, dans W ou le souvenir d’enfance, joue avec la mémoire lacunaire. Il écrit autant les trous que les souvenirs. Sa manière d’assumer l’incomplétude montre que la résistance – le silence de la mémoire – peut devenir matériau littéraire.
Ces exemples rappellent que la résistance n’est pas une anomalie : elle fait partie intégrante du travail de création.
Comment accueillir la résistance plutôt que la forcer ?

La tentation est grande de lutter contre la résistance : se forcer, multiplier les exercices, imposer une discipline stricte. Mais cette contrainte renforce souvent la censure.
La voie la plus féconde consiste à accueillir la résistance, à l’écouter, à la transformer en matière d’écriture.
Mettre des mots sur le non-mot
On peut commencer par écrire sur l’impossibilité même d’écrire :
“Aujourd’hui, je ne trouve pas les mots. Ils se cachent. Je sens leur présence mais ils m’échappent.”
Cette écriture du blocage permet de déplacer la frustration. On écrit autour de la résistance, au lieu de la nier.
Détourner le chemin
Quand les phrases refusent de venir, on peut emprunter des chemins de traverse : écrire une liste de mots, dessiner une image, noter une métaphore. L’écriture devient fragmentaire, mais elle existe.
Une participante à un atelier me confiait : “Je n’arrivais pas à écrire sur ma colère. Alors j’ai dessiné un volcan et j’ai noté trois mots : lave, feu, explosion. C’est tout. Mais c’était déjà ça.”
Accepter l’inachèvement
Il n’est pas nécessaire d’écrire un texte complet pour que l’écriture ait une valeur. Une phrase suffit. Un mot, même. Accepter le fragment libère de l’injonction à la performance. La résistance se transforme alors en rythme : aujourd’hui, une phrase ; demain, peut-être davantage.
Exercice d’écriture : écrire la résistance elle-même
Voici une proposition concrète :
Consigne :
Imagine que la résistance soit une présence extérieure. Décris-la comme une personne, un animal, un paysage. Dialogue avec elle. Demande-lui ce qu’elle cherche à protéger, ce qu’elle redoute, ce qu’elle attend de toi.
Cet exercice a une double vertu :
- Il déplace le blocage en dehors de soi, permettant de le regarder à distance.
- Il transforme l’impossibilité en matière littéraire : la résistance devient personnage.
On peut prolonger l’exercice en notant les réponses supposées de la résistance : “Je suis là pour t’empêcher de souffrir.”“Je te retiens car tu n’es pas prêt.” Cette mise en scène crée un espace de dialogue intérieur où la résistance cesse d’être ennemie.
La résistance comme seuil symbolique
La résistance peut être comprise non seulement comme un blocage, mais comme un passage. Elle marque un seuil, une frontière à franchir.
Un rite d’initiation
Chaque fois que l’écriture se fige, quelque chose s’éprouve de l’ordre de l’épreuve initiatique. On ne peut pas accéder aux mots sans traverser une forme de tremblement. La résistance devient alors un rite : accepter le silence avant de dire.
Une épreuve de vérité
La résistance rappelle que l’écriture n’est pas un geste anodin. Elle engage l’être. Elle oblige à se demander : “Ai-je vraiment envie d’écrire cela ? Qu’est-ce que je redoute ?” En ce sens, elle agit comme un révélateur.
La porte invisible
On peut voir la résistance comme une porte : fermée au premier abord, mais qui s’entrouvre si l’on accepte d’en chercher la clé. Elle devient alors non plus un obstacle, mais un seuil vers un autre espace de soi.
Conclusion
La résistance à écrire prend des formes multiples : silence, bavardage, effacement, doute. Elle touche les anonymes comme les grands écrivains. Elle n’est pas une anomalie mais une étape, parfois douloureuse, souvent protectrice, toujours signifiante.
La considérer comme un échec revient à manquer ce qu’elle a à dire. La considérer comme un signe, c’est lui rendre sa dignité. Alors la résistance cesse d’être une muraille : elle devient un passage, un seuil à franchir.
Écrire malgré elle, avec elle, ou autour d’elle, c’est accepter que les mots ne soient jamais donnés d’avance, qu’ils se gagnent, se cherchent, se risquent.
La page blanche, dès lors, n’est pas vide. Elle est pleine de cette résistance qui veille, qui interroge, qui attend. Et c’est peut-être dans cette attente, dans cette écoute, que se prépare le texte à venir.
👉 Et toi ? Si tu souhaites explorer ces résistances dans un espace collectif et bienveillant, les ateliers Plume et le Club Psychoplume offrent un lieu où la page blanche elle-même devient matière d’écriture.
En savoir plus sur Psycho-Plume
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






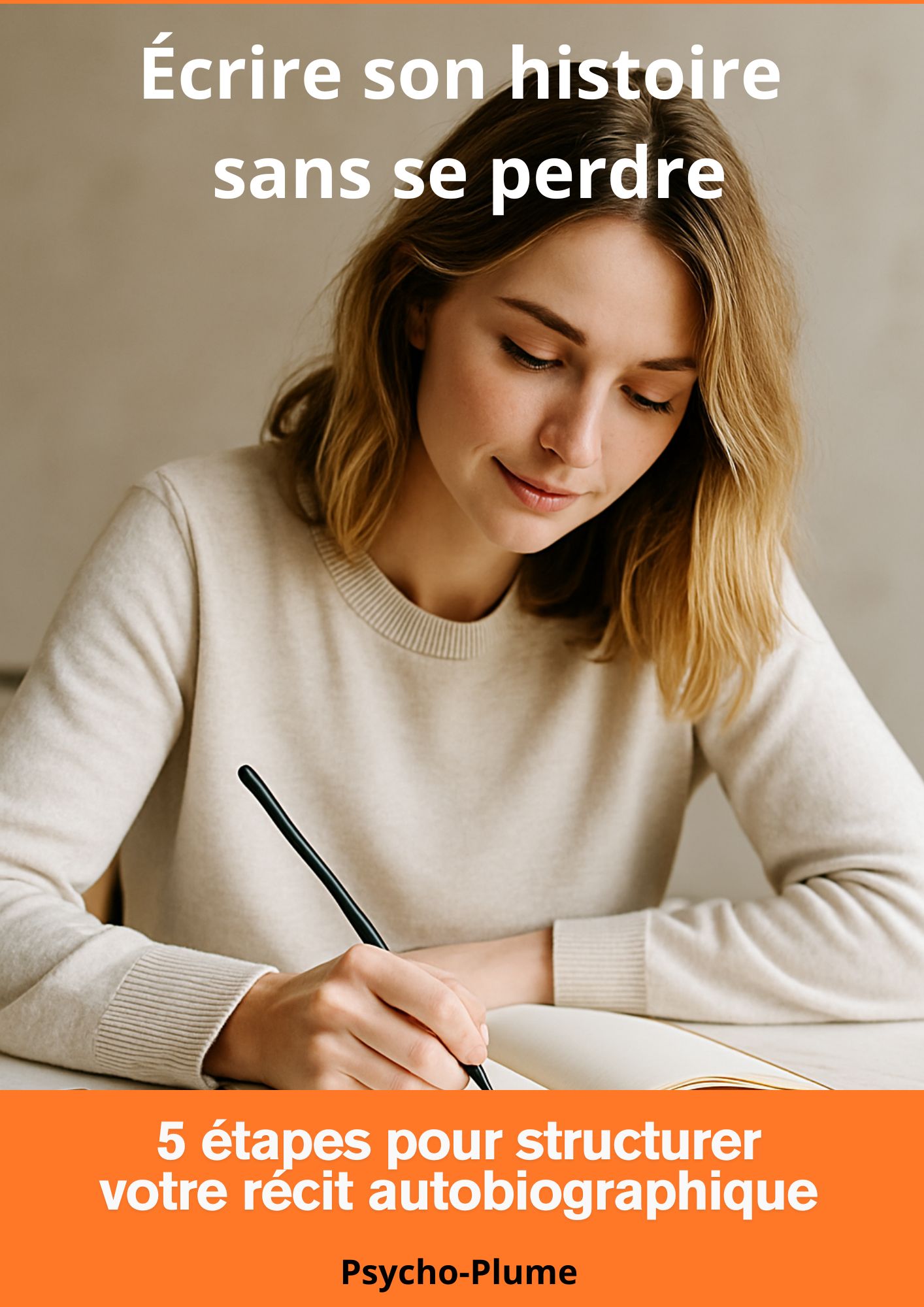
2 commentaires
Eva
Merci Olivia sur ton regard expert, sensible et bienveillant sur l’écriture. Je n’avais jamais pensé aux visages cachés de la résistance, ni au faux-self qui a dû me faire écrire des pages et des pages avant de me rendre compte que je m’ennuyais en me relisant. Tu nous rappelles qu’écrire consiste véritablement à ouvrir des portes, et cela attise l’envie ! Je pratiquerai ton exercice sur la résistance dès que le cas se produira.
Fabienne - AnimaSoins au Naturel
Merci Olivia. J’aime beaucoup ta vision sur le fait de mettre des mots sur le non-mot, c’est accepter de frôler l’invisible, de s’asseoir dans le silence pour en écouter les failles.
Depuis peu et grâce à toi, je remarque combien l’écriture engage bien plus que la main ! elle engage l’être tout entier. Et si parfois elle nous arrête, c’est pour nous demander : “As-tu vraiment envie de dire cela ? Es-tu prête à te révéler ?”. Chaque jour je me questionne un peu plus avec une intime conviction.
Écrire malgré tout, écrire autour, écrire même un seul mot : c’est franchir un passage. C’est reconnaître que l’écriture n’est pas un simple geste, mais une épreuve de vérité, un souffle de l’âme qui cherche sa forme. Et surtout merci de nous proposer ces exercices et bien plus…