
Écrire, être lu, se découvrir : le pouvoir d’une lecture thérapeutique du texte
Il y a des textes qui s’écrivent comme des appels.
Ils naissent d’un élan plus fort que nous : la nécessité de comprendre, d’apaiser, de dire enfin.
Mais un texte, à lui seul, ne suffit pas toujours.
Entre ce qu’on écrit et ce qu’on vit, il reste souvent une zone d’ombre, un lieu où la parole a besoin d’un autre pour se déplier.
C’est là qu’intervient la lecture thérapeutique : non pas une analyse du texte, mais une écoute du vivant qui s’y manifeste.
Écrire : le premier geste du travail sur soi
Tout commence par un geste simple : celui d’écrire.
Avant même d’être un acte artistique, l’écriture est un acte de régulation.
Elle permet de contenir ce qui déborde, de déposer ce qui ne trouve pas d’autre lieu.
J’ai souvent observé que, dès les premières lignes, les personnes sentent déjà un apaisement physique : les épaules se relâchent, la respiration s’allonge, le corps retrouve une forme de rythme.
Dans cet espace, la vérité n’est pas celle des faits, mais celle du ressenti.
Écrire, c’est parfois mettre en forme le chaos intérieur, le traduire pour ne plus en être prisonnier.
Beaucoup commencent par raconter : un souvenir, un événement, une douleur.
Mais peu à peu, le texte échappe à la narration ; il devient une exploration.
On confond souvent l’écriture thérapeutique avec le journal intime ou la confession.
Mais elle s’en distingue profondément.
Le journal intime décrit et explore ; l’écriture thérapeutique travaille.
Elle ouvre des brèches symboliques, elle fait surgir l’inconscient à travers des images, des rythmes, des mots qui reviennent.

Quand on écrit “pour soi”, on reste parfois enfermé dans sa propre boucle.
Mais quand on écrit “pour être entendu”, sans chercher à plaire, quelque chose change.
Le texte devient alors une adresse, un espace tiers, une manière de se relier au monde.
C’est à ce moment que la lecture peut jouer son rôle.
Être lu : le moment de la rencontre
Être lu, c’est se risquer à être vu autrement.
Non pas dans l’exposition, mais dans la rencontre.
Il existe une qualité de lecture qui, quand elle est juste, agit presque comme une fonction thérapeutique.
C’est celle où le lecteur n’interprète pas, ne corrige pas, mais écoute.
Lorsque je lis un texte, je n’y cherche jamais la beauté formelle, ni la cohérence narrative.
Je lis les interstices : les hésitations, les glissements de ton, les métaphores récurrentes.
Je lis les mots qui résistent, ceux qui reviennent trop souvent ou pas assez.
Je lis le rythme, les silences, les phrases suspendues — tout ce que le corps dépose dans la langue sans le savoir.
Cette lecture-là transforme la relation à soi.
Une participante m’écrivait un jour :
“Je croyais parler de mon père, mais j’ai compris que j’écrivais pour l’enfant que j’étais quand il me manquait.”
C’est exactement cela : être lu, c’est découvrir un autre sens sous celui qu’on croyait avoir écrit.
La lecture bienveillante agit comme un miroir psychique.
Elle permet au sujet de se voir sans se juger.
Et c’est cette reconnaissance silencieuse qui initie la transformation.
Dans mes programmes, j’observe souvent que ce moment de lecture marque un tournant.
L’écriture cesse d’être un monologue intérieur.
Elle devient un dialogue symbolique.
Quelque chose circule.
L’auteur se met à exister non plus seulement à travers ce qu’il dit, mais à travers ce qu’un autre entend.
Se découvrir : le retour comme espace d’élaboration
La lecture, pour devenir soin, doit se prolonger par une réponse.
Lire, c’est accueillir ; répondre, c’est élaborer.
Dans mes retours, je n’explique jamais un texte : j’accompagne son mouvement.
Je regarde où il pousse, où il retient, où il tremble.

Répondre à un texte, c’est écrire à l’intérieur de l’écriture de l’autre.
C’est écouter la voix derrière les mots et lui renvoyer une forme de reflet.
J’emploie le “tu”, mais quand je le fais, il n’est pas une familiarité : il est une main tendue.
Le retour n’est pas un commentaire, c’est un espace d’écoute matérialisé.
Certains participants me disent :
“Vos retours me font écrire à nouveau.”
Et c’est là, précisément, que le travail thérapeutique se déploie.
Le texte relance la parole.
Le regard extérieur, loin de figer le sens, ouvre une nouvelle voie.
Dans ce processus, le temps joue un rôle fondamental.
Je ne réponds pas dans l’immédiateté, mais suffisamment rapidement pour que celui qui a écrit soit eencore au plus proche de son émotion et du processus permis par l’écriture.
Le retour favorise la symbolisation.
C’est une autre manière de dire à la personne : “Ton texte compte, je prends le temps de l’entendre.”
Là encore, ce n’est pas la perfection littéraire qui importe, mais le mouvement psychique.
Certains textes sont bruts, fragmentés ; mais ce sont souvent les plus féconds.
Ils témoignent d’un déplacement en cours, d’une pensée qui cherche à se reconstituer.
La lecture thérapeutique : un acte d’écriture en retour
Répondre à l’écriture par l’écriture, c’est prolonger le fil invisible qui unit deux voix.
Le texte devient le tiers thérapeutique, un espace partagé où s’échangent des traces, des émotions, des symboles.
Je ne lis pas “une personne”, je lis “un mouvement”.
Celui de la vie qui se remet à circuler par les mots.
Chaque retour que j’écris est lui aussi un texte.
Il me demande de me laisser traverser, d’entrer dans le langage de l’autre sans m’y perdre, puis de revenir à ma propre langue pour lui répondre.
C’est un équilibre délicat entre empathie et distance, écoute et discernement.
La lecture thérapeutique, telle que je la conçois dans Plumes Thérapeutiques, s’inscrit dans une tradition de correspondances intérieures.
Chaque échange devient une lettre silencieuse, un dialogue différé entre deux écritures.
Le texte premier ouvre, la lecture accompagne, la réponse ou le texte suivant relance.
C’est une respiration à trois temps : écrire, être lu, être relu.

Ce processus permet une véritable intégration psychique.
L’écriture met en mots ; la lecture reconnaît ; la réponse symbolise.
Et c’est cette triangulation qui transforme la parole en expérience intérieure.
Dans la pratique, cela se manifeste souvent par une phrase comme :
“Je ne pensais pas que c’était cela que je voulais dire.”
Ce moment de surprise, d’auto-découverte, est l’un des plus précieux : c’est le signe que le texte a travaillé.
Répondre par l’écriture, c’est aussi faire confiance à la lenteur.
Le sens ne se livre pas tout de suite ; il se dépose.
L’essentiel est dans le regard, dans la présence symbolique que ce regard crée.
Consignes d’écriture
🪶 1. Le texte-miroir
Relis un texte que tu as écrit il y a quelques semaines ou quelques mois.
Lis-le non pas pour corriger, mais pour entendre.
Que ressens-tu en le lisant aujourd’hui ?
Y a-t-il une phrase qui te touche différemment ?
Écris une réponse à cette phrase, comme si elle t’était adressée par quelqu’un d’autre.
🪶 2. Le mot qui appelle
Choisis un mot dans ton dernier texte, un mot qui te semble lourd, ou au contraire lumineux.
Ferme les yeux.
Laisse venir une image, une sensation, une phrase qui s’y relie.
Écris à partir de là, sans chercher à comprendre : ton inconscient sait déjà ce qu’il veut dire.
En guise de conclusion
Écrire, être lu, se découvrir : c’est le cœur même du travail thérapeutique par l’écriture.
Dans ce va-et-vient entre soi et l’autre, entre parole et silence, quelque chose se recompose.
Les mots deviennent passage, lien, respiration.
Être lu, c’est être reconnu.
Être entendu dans ses mots, c’est être accueilli dans son être.
Et parfois, cela suffit à déclencher un mouvement de vie.
La lecture thérapeutique n’est pas une méthode ; c’est une posture.
Une manière d’habiter la langue de l’autre avec respect, de lui offrir un écho juste, de permettre à la parole d’aller un peu plus loin.
🕊 Dans Plumes Thérapeutiques, cette correspondance entre écriture et lecture se vit au fil des textes et des retours.
C’est un espace pour écrire, comprendre et transformer.
✨ Cette approche sera aussi au cœur du défi “Les mots pour se rejoindre”, qui aura lieu du 13 au 19 novembre : une semaine d’exploration autour de la parole écrite, pour renouer avec la voix intérieure qui sait, même quand on ne sait plus comment dire.
Découvrir les masterclass et le défi
En savoir plus sur Psycho-Plume
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






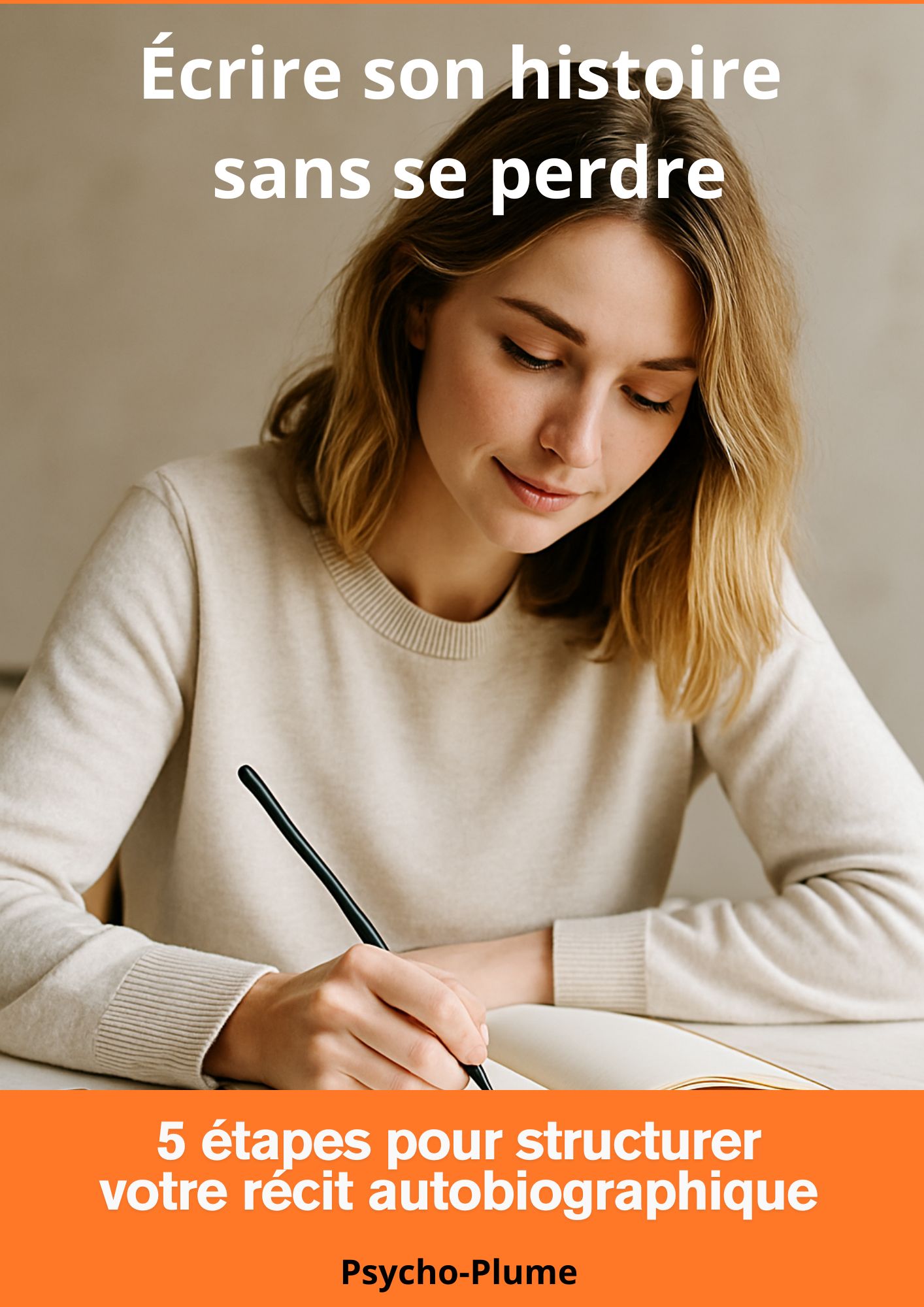
Un commentaire
fanbeautifule34894a030
Je suis super enthousiaste de refaire un » tour de piste » avec toi Olivia !
Tes mots me touchent beaucoup,
À tout bientôt,
Sabine