
Écrire pour retrouver la joie : un chemin doux après le burn-out, la fatigue ou le doute
Introduction : quand la joie semble absente
Il y a des périodes de vie où l’on ne sait plus très bien où est passée la joie. Non pas le bonheur bruyant, l’euphorie ou l’optimisme de surface. Mais cette joie plus profonde, plus tranquille, qui ressemble à une chaleur discrète sous la peau, un regard qui s’éclaire, une envie de chanter sans raison. Cette joie-là, certaines personnes la perdent sans bruit.
Elle glisse doucement, aspirée par le trop-plein de responsabilités, les chocs de l’existence, les longues traversées de vide. On parle alors de fatigue, de lassitude, de manque d’élan. On se sent loin de soi, déconnectée, comme anesthésiée.
Dans ces moments, l’écriture peut devenir un fil. Fragile au départ, mais régénérateur. Ce que je propose ici, ce n’est pas une recette magique pour « aller mieux ». Mais une réflexion sur la joie comme processus vivant, et sur l’écriture comme outil symbolique pour la convoquer, même quand on croit ne plus y avoir accès.
Cet article fait partie de l’événement “Je choisis la joie, même quand c’est imparfait” organisé par Ana, du site Origami Mama. Elle aide les mamans à retrouver leur voix et leur voie, et à vivre une vie qui leur ressemble. J’apprécie beaucoup ce site et j’ai trouvé cet article particulièrement pertinent pour ceux qui souhaite mettre en place de saines habitudes : https://origami-mama.fr/ma-morning-routine-pour-commencer-ma-journee-avec-energie-et-serenite/
La joie ne se commande pas… mais elle peut être invitée
Peut-on choisir la joie? On ne choisit pas de se sentir vides, éteints ou submergés. Et la joie, parfois, semble appartenir à un autre monde.
Pourtant, en psychologie, on distingue l’émotion (passagère, réactive) de l’état affectif plus stable.
La joie n’est pas qu’une réaction à un événement. Elle peut être une disposition, une manière d’être au monde. Et cette disposition, elle se cultive. Non pas en s’obligeant à voir la vie en rose, mais en recréant en soi des conditions propices : s’accorder du temps, revenir à ses sensations, à ce qui fait sens. L’écriture est l’un de ces espaces.
Quand l’écriture rouvre les chemins de la joie
L’écriture, dans son versant introspectif, n’est pas seulement un exutoire. C’est une exploration symbolique. En posant les mots sur la page, on se recontacte avec des fragments oubliés de soi. On réactive des souvenirs, des images, des désirs, des traces.
Certaines participantes me disent, après une séance : « J’avais oublié que j’aimais tant la mer », « En écrivant cette scène, j’ai ressenti une joie que je n’avais pas eue depuis longtemps ». Ce n’est pas la vie qui a changé. C’est leur regard. Et ce regard a été réactivé par le mot, par la mise en forme, par l’attention posée.
Dans mes accompagnements, je parle souvent de mouvement. Une personne en lien avec elle-même retrouve une forme d’élan, même infime. Et cet élan peut être joyeux, sans pour autant nier le reste.
La joie n’est pas l’opposée de la tristesse. Elle est une manière de sentir qu’on est vivant.
Symbolique de la joie dans l’écriture autobiographique
Joie, bonheur, euphorie : nuances essentielles
Avant de poursuivre, il me semble utile de distinguer trois notions souvent confondues : la joie, le bonheur, et l’euphorie.
- Le bonheur est souvent perçu comme un état global, une condition durable, recherchée comme un but à atteindre. Mais il peut aussi devenir une norme pesante, une idée figée qui enferme.
- L’euphorie, elle, est une intensité passagère, presque enivrante, mais parfois trompeuse. Elle peut masquer une fuite ou une compensation.
- La joie, enfin, est souvent plus discrète, plus incarnée. C’est une sensation qui traverse le corps, un frisson, un éclat, une reconnaissance intime. Elle est souvent sans objet : elle ne répond à rien de tangible, mais émerge d’un accord profond entre soi et le monde.
Dans l’écriture, ces distinctions prennent sens : on peut décrire un moment de bonheur (un événement heureux), une euphorie (une soirée exubérante), ou une joie (le simple fait de marcher sous la pluie avec apaisement). L’exploration de la joie, en ce sens, est une manière de redonner de l’espace à ce qui est vivant, sans emphase ni déni.
La joie dans les textes autobiographiques
Dans les textes autobiographiques que j’accompagne, la joie est rarement annoncée d’emblée. Elle surgit souvent au détour d’une scène sensorielle : un souvenir d’enfance dans la nature, le rire d’un enfant, la présence d’un animal, le parfum d’un plat. La joie n’est pas un mot, c’est une texture émotionnelle.
Jung disait que l’écriture de soi permet d’intégrer l’ombre, mais aussi de faire jaillir les archétypes du vivant. La joie, dans ce cadre, peut être vue comme un mouvement de l’âme vers l’unité : un moment où le moi et le soi se rencontrent.

Spinoza, lui, décrivait la joie comme le sentiment d’un accroissement de notre puissance d’exister. L’écriture, alors, redevient un acte existentiel.

Pour illustrer cela, pensons aux textes de Philippe Delerm, qui capte la joie dans des instants infimes : croquer une pomme, marcher au soleil, sentir l’odeur du pain grillé.

Ou encore Annie Ernaux, qui, dans un style bien plus clinique, fait apparaître des lueurs de joie au creux des descriptions de l’enfance ou du désir. La joie littéraire est souvent fragile, presque inavouée, mais d’autant plus bouleversante.

Dans tes écrits, même si tu crois écrire sur la douleur ou l’oubli, observe : parfois, une phrase s’éclaire. C’est là que la joie passe, à bas bruit.
Jung disait que l’écriture de soi permet d’intégrer l’ombre, mais aussi de faire jaillir les archétypes du vivant. La joie, dans ce cadre, peut être vue comme un mouvement de l’âme vers l’unité : un moment où le moi et le soi se rencontrent. Spinoza, lui, décrivait la joie comme le sentiment d’un accroissement de notre puissance d’exister. L’écriture, alors, redevient un acte existentiel.
Deux consignes pour éveiller la joie en soi
Voici deux autres invitations à explorer :
Consigne : « La joie d’enfant »
Ferme les yeux et laisse revenir une scène d’enfance où tu t’es sentie libre, vivante, joyeuse. Décris-la le plus précisément possible, sans jugement. Ensuite, relis ton texte et demande-toi : qu’est-ce qui, aujourd’hui encore, pourrait te relier à cette même sensation ?
Consigne : « Et si la joie revenait demain ? »
Imagine que demain matin, sans raison, la joie revient dans ta vie. Qu’est-ce qui changerait dans ta manière de te lever, de parler, de marcher, de regarder ? Écris une journée de demain traversée par cette joie. Pas une joie factice : une joie intime, tranquille.
Ces consignes peuvent être faites sans attente, simplement comme des portes. Il suffit de les entrouvrir.
Pourquoi il est si difficile d’écrire la joie ?
Il est frappant de constater combien il est plus facile d’écrire sur la douleur, la perte, le traumatisme. C’est compréhensible : la souffrance appelle à être exprimée, déposée. Mais écrire la joie demande un autre mouvement : celui de la confiance.
Beaucoup de personnes ressentent une culpabilité à écrire sur ce qui va bien, comme si cela était indécent ou fragile. D’autres ont peur de ne pas trouver les mots justes, de trahir l’intensité du ressenti. Et parfois, on a simplement oublié comment y accéder.
L’écriture, alors, devient un entraînement discret : écrire même de minuscules moments, même des parcelles de joie. C’est ainsi qu’on déconstruit l’idée qu’il faut souffrir pour écrire, et qu’on réhabilite la légitimité du plaisir d’être.
Conclusion : la joie comme retour vers soi
Choisir la joie, ce n’est pas nier ce qui fait mal. Ce n’est pas se forcer à être lumineuse quand on se sent brisée. C’est réapprendre, à son rythme, à ouvrir une fenêtre. Laisser entrer un peu d’air. Tenir un stylo comme on tiendrait une main. Noter une image, une phrase, une couleur qui fait du bien.
Et puis, un jour, sans s’en rendre compte, se surprendre à sourire en écrivant. Ou à retrouver un frisson. C’est peut-être cela, la joie. Une forme d’intégrité retrouvée. Une vibration de l’être.
La joie, ainsi, ne se commande pas — mais elle se prépare. Elle demande des espaces d’accueil, des temps de lenteur, des gestes minuscules. Elle revient par effraction dans une phrase qu’on ne pensait pas écrire. Elle s’infiltre quand on écrit sans but, juste pour le goût de laisser trace.
Il n’y a pas de bonne ou mauvaise manière d’écrire la joie. Il y a seulement ta manière, ton rythme, ton accès. La joie est peut-être ce qui surgit quand tu arrêtes de vouloir bien faire, et que tu te laisses simplement traverser.
Pour aller plus loin :
→ Tu peux t’inscrire au Club PsychoPlume, un espace d’écriture douce et quotidienne, pour te reconnecter à toi par les mots :
https://psychoplume.com/club-psycho-plume/
En savoir plus sur Psycho-Plume
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






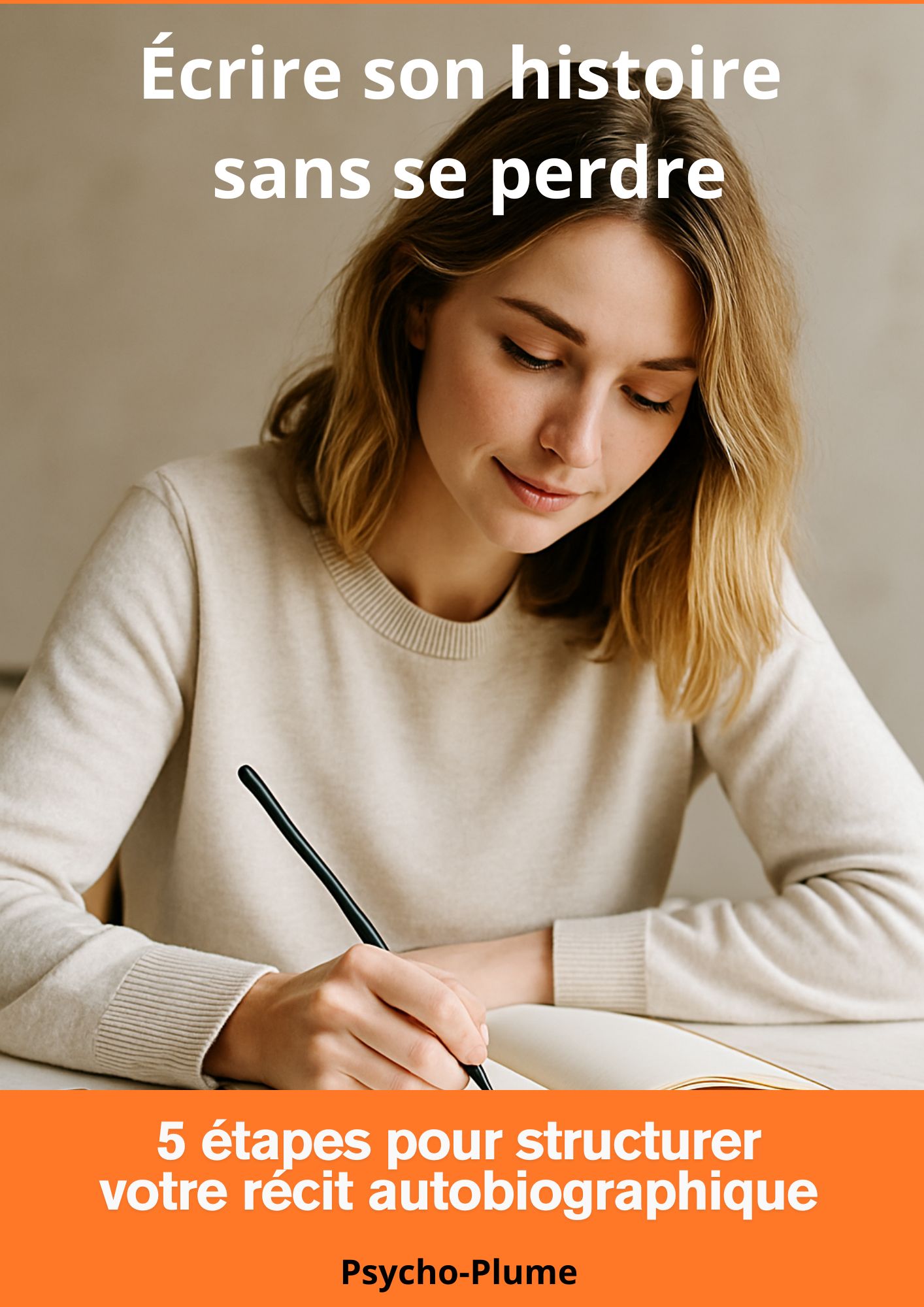
4 commentaires
Valérie Matime
Ta manière de parler de la joie, sans l’idéaliser, mais en l’ancrant dans le corps, la mémoire, les petits gestes… m’a profondément touchée.
J’ai eu plusieurs fois ce frisson que tu décris, celui qui surgit au détour d’une phrase, comme si l’écriture réveillait un morceau oublié de soi. Ce n’est pas spectaculaire, mais c’est vivant. Et ça suffit pour continuer.
Je repars avec l’envie d’écrire “juste pour le goût de laisser trace”, sans pression, avec confiance. Merci pour cette respiration douce dans un monde trop pressé.
Isabelle
Un bel article qui nous invite à nous connecter à cette émotion. On parle souvent des autres émotion, et celle ci semble oubliée, mise de côté. J’aime beaoucoup l’exercice sur la joie d’enfant.
noirenvoyage
Ta distinction entre joie, bonheur et euphorie m’a beaucoup parlé :
“La joie, enfin, est souvent plus discrète, plus incarnée.”
.
C’est exactement le cœur d’un voyage authentique : ne pas courir après un grand frisson, mais cueillir les petits instants où le monde nous fait signe – un rayon de lumière, une phrase écrite, un silence partagé. En écriture comme en voyage, c’est là que la magie opère, dans la simplicité. Merci pour cet éclairage tout en délicatesse.
Sylvie
Je suis bien d’accord sur le fait qu’ « écrire même de minuscules moments » nous sensibilise peu à peu aux petits moments de joie quotidiens. En tant qu’auteur de haïkus, je note chaque jour les micro-événements qui ont retenu mon attention. Lorsque je les relis ensuite pour écrire des tercets, je peux ressentir encore plus profondément joie et gratitude pour ces moments vécus.