
Écriture de soi, écriture thérapeutique, thérapie narrative : trois chemins pour reprendre la plume de sa vie
Nous vivons dans des histoires. Certaines sont douces, elles nous accompagnent comme un fil de soie, nous donnent un ancrage et une continuité. D’autres sont lourdes, répétées si souvent qu’elles se sont gravées dans notre chair : “Tu n’y arriveras jamais.”, “Tu es fragile.”, “Tu es comme ton père.” Ces récits dominants deviennent parfois des prisons.
Alors, un jour, vient le besoin de reprendre la plume. D’écrire pour se souvenir, pour se dire autrement, pour se libérer. Mais écrire sur soi ne recouvre pas une seule pratique : il existe l’écriture de soi, tournée vers la mémoire et la trace ; l’écriture thérapeutique, qui fait des mots un chemin de soin ; et la thérapie narrative, qui, avec un thérapeute, aide à déconstruire les histoires oppressives pour en inventer d’autres.
Trois chemins distincts mais reliés par une même intuition : nos vies sont des récits, et ces récits peuvent changer.
L’écriture de soi : mémoire et transmission
Écrire sur soi est une pratique très ancienne. On pourrait même dire que l’humanité n’a cessé de chercher à se dire. Déjà, dans l’Antiquité, Marc Aurèle rédigeait ses Pensées pour moi-même, qui n’étaient pas destinées à être publiées, mais qui constituent un témoignage intime et philosophique de sa manière de vivre.

Au Moyen Âge, les écrits de mystiques comme Marguerite Porete ou Catherine de Sienne mêlaient expérience intérieure et narration de soi.
Puis, au IVᵉ siècle, saint Augustin, avec ses Confessions, pose l’un des premiers jalons de l’autobiographie en Occident.
Rousseau, au XVIIIᵉ siècle, inaugure une autre ère. En écrivant ses Confessions, il proclame vouloir montrer “un homme dans toute la vérité de la nature”. C’est un geste nouveau : affirmer que sa propre vie mérite d’être racontée dans son authenticité, avec ses zones d’ombre et de lumière.
Au XXᵉ siècle, la réflexion s’affine. Philippe Lejeune parle du pacte autobiographique : lorsqu’auteur, narrateur et personnage portent le même nom, il y a engagement à dire “je” en vérité.
À l’inverse, Serge Doubrovsky invente le terme autofiction pour désigner une écriture où l’expérience personnelle se mêle à l’imaginaire, brouillant volontairement les frontières entre réalité et invention.
Annie Ernaux, enfin, transforme sa vie en œuvre collective, où l’intime devient un miroir de la société.
L’écriture de soi prend ainsi mille formes :
- Le journal intime, refuge secret de millions de vies anonymes, de Kafka à Virginia Woolf.
- Les mémoires, qui transmettent une expérience à la postérité.
- L’autobiographie, qui revendique une quête de vérité.
- L’autofiction, qui assume l’entrelacement du vrai et du fictif.
Ici, l’intention n’est pas thérapeutique. On écrit pour témoigner, se souvenir, parfois créer une œuvre d’art. Mais l’effet peut aller au-delà de cette intention. Écrire sur soi peut apaiser, clarifier, redonner une continuité à une identité fragilisée.
👉 Exemple : une femme rédige un cahier de souvenirs pour ses enfants. Elle croit seulement transmettre. Mais en écrivant une scène d’enfance douloureuse, elle se surprend à ressentir une paix nouvelle. L’écriture de soi ne se veut pas thérapeutique, mais elle ouvre parfois une brèche où une forme de réparation s’invite.
J’accompagne des personnes dans cette écriture de soi dans le Programme Plumes autobiographiques qui est pensé à la fois pour guider l’écriture et proposer un soutien psychologique selon ce qui émerge.
L’écriture thérapeutique : les mots comme soin
Parfois, écrire n’est pas une question d’art, mais de survie. Il y a des mots trop lourds pour être dits à voix haute. Alors on les dépose sur le papier. Non pour être lus, mais pour qu’ils trouvent un lieu où exister autrement.
C’est cela, l’écriture thérapeutique : écrire pour se libérer, pour se transformer, pour soigner des parts de soi.
Les fondements scientifiques
Dans les années 1980, le psychologue James Pennebaker a montré que le fait d’écrire de manière expressive sur ses émotions ou ses traumatismes avait des effets mesurables : baisse du stress, meilleure régulation émotionnelle, amélioration du système immunitaire. Ces résultats ont été confirmés par de nombreuses recherches.
Mais au-delà des chiffres, chacun l’a expérimenté : noircir une page, et sentir qu’on respire mieux après.
Des pratiques variées
- Un journal quotidien pour clarifier ses ressentis.
- Des consignes d’écriture comme : “Écris une lettre à ta peur.”
- Des ateliers ou programmes accompagnés, où l’écriture se fait dans un cadre protecteur.
- Un accompagnement individuel avec un psychologue ou un art-thérapeute
Dans un programme comme Plumes thérapeutiques, l’accompagnement est essentiel. Les consignes ouvrent des portes insoupçonnées, la progression donne une sécurité, le retour éventuel éclaire ce qui s’écrit. Le cadre ne contraint pas : il protège, il autorise.
Une finalité claire
Écrire de cette façon ne fait pas disparaître les blessures, mais transforme la manière de les porter.
- Le chaos intérieur trouve une forme.
- Les souvenirs épars se rassemblent.
- Une trame nouvelle se dessine.
La thérapie narrative : réécrire son histoire avec un thérapeute
La thérapie narrative est une psychothérapie à part entière, née en Australie et en Nouvelle-Zélande avec Michael White et David Epston dans les années 1980.

Les influences théoriques
Elle s’inspire de Michel Foucault, qui a montré comment les discours façonnent nos identités et nos rapports de pouvoir. Elle s’appuie aussi sur Jerome Bruner, psychologue cognitiviste, qui a défendu l’idée que nous pensons et organisons nos vies avant tout de façon narrative.
De cette rencontre est née une approche radicale : nos problèmes ne sont pas des vérités intérieures immuables, mais des récits dominants qui se sont imposés. Et tout récit peut être déconstruit, puis réécrit.
Un changement de perspective
Un patient dit : “Je suis dépressif.”
Le thérapeute répond : “La dépression s’invite dans votre vie. Parfois elle prend toute la place, parfois vous lui résistez.”
En une phrase, l’histoire change. Le problème n’est plus collé à l’identité. Il devient un personnage extérieur, avec lequel on peut dialoguer, négocier, résister.
Les pratiques narratives
La thérapie narrative invite à :
- externaliser le problème,
- chercher les moments où il n’a pas dominé,
- réécrire l’histoire en donnant valeur à des expériences négligées,
- consolider les nouveaux récits par des documents thérapeutiques (lettres, certificats, récits symboliques).
Ces “documents” ont une force particulière : ils matérialisent la transformation. Recevoir une lettre écrite par le thérapeute, qui rappelle tes résistances et tes forces, c’est ancrer le nouveau récit dans le concret.
La finalité
La thérapie narrative n’est pas seulement un apaisement. C’est une restauration de dignité. Elle permet au sujet de se définir autrement que par ses blessures, de se réapproprier sa voix, de retrouver une agentivité perdue.
👉 Exemple : un adolescent enfermé dans l’histoire “Je suis un raté” découvre, au fil des séances, les petites résistances qu’il a déjà menées : avoir aidé un camarade, avoir tenu bon dans une difficulté. Ces fragments sont rassemblés, écrits, partagés. Peu à peu, il cesse de se définir par l’échec et commence à se raconter comme “celui qui résiste, celui qui apprend, celui qui construit”.
Ce qui relie et ce qui distingue
Écriture de soi, écriture thérapeutique, thérapie narrative : toutes reposent sur la puissance des mots, toutes offrent une mise à distance, toutes ouvrent la porte à des récits différents. Elles partagent cette intuition fondamentale : les histoires façonnent nos vies, mais elles ne sont jamais définitives.
Mais elles se distinguent par leur cadre et leur finalité :
- L’écriture de soi témoigne, transmet, crée.
- L’écriture thérapeutique soigne, apaise, transforme, dans un cadre accompagné.
- La thérapie narrative déconstruit et réinvente, dans une relation thérapeutique codifiée.
Trois façons de reprendre la plume de sa vie, selon qu’on cherche à laisser une trace, à se transformer seul ou accompagné, ou à travailler cliniquement avec un thérapeute.
Un livre aux chapitres multiples
On pourrait dire que l’écriture de soi compose le livre de la mémoire, que l’écriture thérapeutique trace le livre du soin, et que la thérapie narrative ouvre le livre de la dignité retrouvée.
Ta vie n’est pas une seule histoire figée. C’est un livre aux chapitres multiples. Certains ont été écrits par toi, d’autres par ta famille, d’autres encore par la société. Certains chapitres sont clairs, d’autres obscurs. Mais la plume reste dans ta main. Tu peux annoter, raturer, ajouter de nouvelles pages. Tu peux choisir d’écrire autrement.
Conclusion
Écriture de soi, écriture thérapeutique, thérapie narrative : trois chemins pour reprendre parole sur ton histoire.
- L’écriture de soi garde la mémoire, témoigne, transmet.
- L’écriture thérapeutique transforme, apaise, libère.
- La thérapie narrative déconstruit, réinvente, restaure.
Toutes rappellent une chose essentielle : il n’existe pas une seule version de toi, mais des histoires possibles. Et la plus grande liberté est de choisir laquelle tu veux continuer à écrire.
✍️ Consigne Psychoplume
Dans ton carnet, essaie :
- Écris une page commençant par : “On m’a toujours raconté que j’étais…”. Laisse surgir les récits dominants.
- Puis écris une autre page commençant par : “Mais il existe aussi une autre histoire de moi…”.
Relis-les l’une à côté de l’autre. Ressens la différence. Tu viens d’expérimenter la puissance des récits pour transformer ton regard sur toi-même.
🌱 Pour aller plus loin avec ton écriture
Si tu sens que cette exploration résonne en toi, sache qu’il existe plusieurs chemins pour continuer à écrire accompagnée :
- Plumes Autobiographiques : un parcours pas à pas pour mettre en mots ton histoire de vie, trouver la forme juste, transmettre ou simplement clarifier ton chemin.
- Plumes Thérapeutiques : un accompagnement progressif où l’écriture devient un outil de transformation intérieure, pour apaiser, comprendre et retrouver confiance.
- Le Club Psychoplume : un espace vivant de partage et d’écriture régulière, pour garder le lien, expérimenter, et sentir la force du collectif.
Chaque chemin a sa couleur, mais tous partent de la même conviction : les mots peuvent devenir un lieu où l’on se retrouve.
En savoir plus sur Psycho-Plume
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






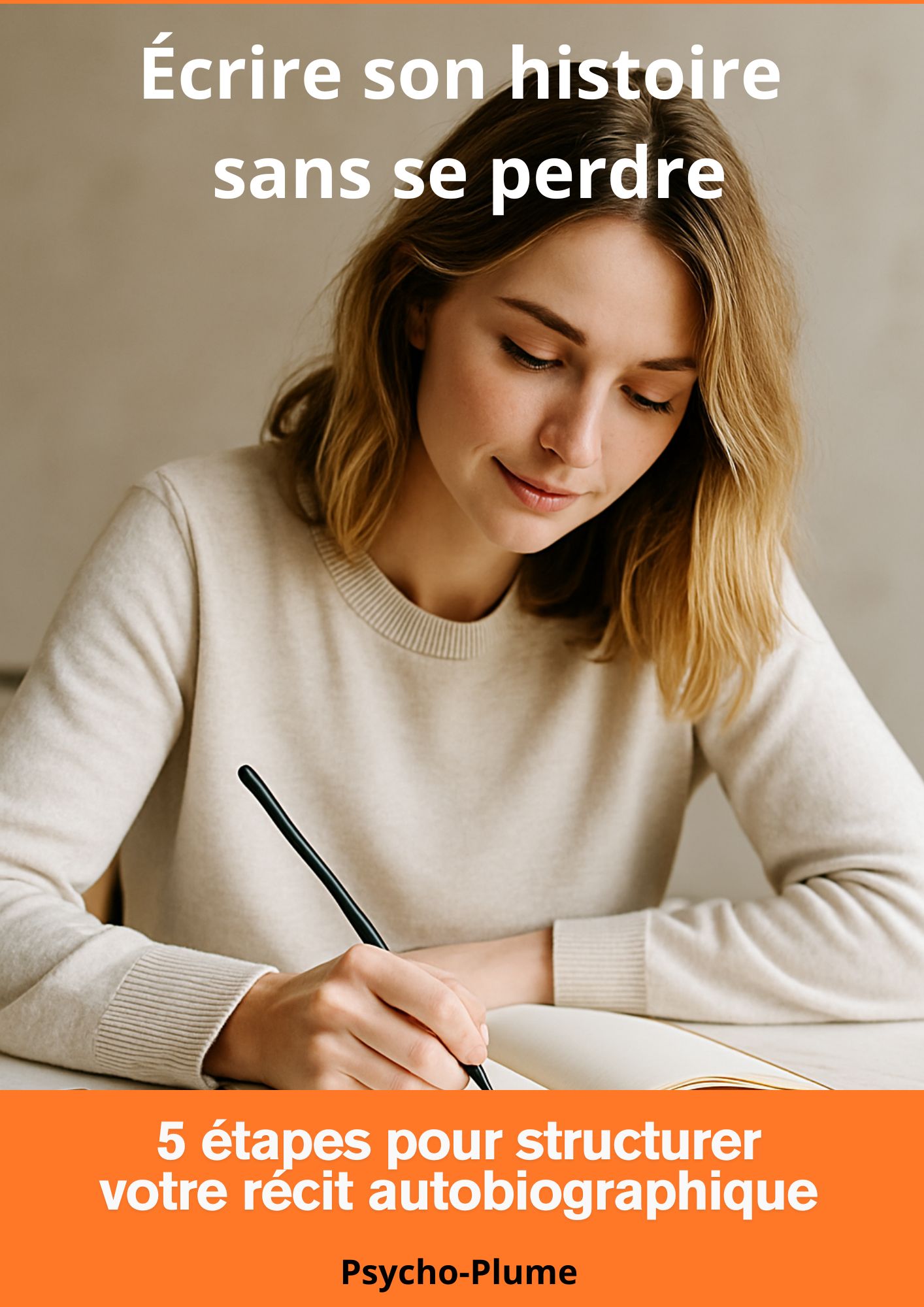
Un commentaire
Miren
Wow… quel article riche et juste ! J’adore comment tu poses ces chemins d’écriture avec leurs nuances, leurs forces et leurs limites. Le passage sur la thérapie narrative m’a particulièrement accrochée : penser le problème comme un “personnage externe” pour sortir de l’auto-identification, c’est une clé puissante. Merci pour ce texte qui fait respirer les mots, ouvre des possibles et redonne de la légitimité à chacun pour reprendre la plume de sa vie.