
Quand le corps devient récit : écrire à partir de ce qu’il ressent
Nous vivons d’abord dans un corps. Avant même d’avoir des mots, nous avons eu des sensations : le chaud, le froid, le manque, la sécurité. Ce corps, premier lieu du vécu, a gardé la mémoire de tout ce qui a traversé notre existence, parfois bien au-delà de ce dont nous nous souvenons consciemment. Il se souvient des gestes de soin, mais aussi des silences, des absences, des tensions. Quand la parole n’était pas encore possible, c’est lui qui parlait. Et, souvent, il continue.
Écrire le corps, c’est s’aventurer dans ce territoire où la mémoire se mêle à la sensation, où les émotions s’expriment à travers la peau, le souffle ou la fatigue. Ce n’est pas décrire une anatomie ni raconter une maladie ; c’est reconnaître que le corps pense, à sa manière, et qu’il dit beaucoup de nous sans que nous en soyons toujours conscients.
Le corps, première mémoire
Le corps est notre mémoire la plus ancienne et la plus fidèle. Ce que la conscience oublie, lui le retient. Il garde trace des chocs, des élans, des retenues. Il se souvient d’une peur par une crispation, d’une perte par un creux dans la poitrine, d’une colère par une tension dans la mâchoire. C’est une mémoire sans mots, mais précise, constante, parfois encombrante.
Quand on écrit à partir du corps, on retrouve cette mémoire enfouie. Les mots ne viennent pas raconter un événement, mais traduire une sensation. Une chaleur, un tremblement, un rythme : autant de portes vers ce qui n’a pas encore été pensé. Souvent, les phrases s’écrivent d’elles-mêmes, sans plan ni intention. Le corps trouve dans le langage une issue : il remet en circulation ce qu’il gardait trop serré.

Antonio Damasio parle de marqueurs somatiques : chaque émotion vécue laisse dans le corps une empreinte physiologique, qui façonne ensuite notre manière d’agir. Didier Anzieu, avec son concept de Moi-peau, a montré combien l’enveloppe corporelle est aussi une enveloppe psychique. Écrire le corps, c’est écrire cette peau : lieu du contact et de la séparation, frontière vivante entre soi et le monde.

Du corps agissant au corps signifiant
Longtemps, nous avons appris à nous méfier du corps : à le discipliner, à le corriger, à le maîtriser. Nous l’avons réduit à sa fonction biologique, oubliant qu’il est aussi le lieu du psychique. Pourtant, tout ce qui n’a pas pu être symbolisé par la parole s’inscrit quelque part dans la chair. Le corps devient alors l’espace où s’exprime ce qui n’a pas trouvé d’autre voie.
L’écriture vient rétablir le lien entre ces deux dimensions : elle relie l’action du corps à la pensée du sujet. Ce passage n’est pas immédiat. Il demande de ralentir, de supporter parfois une certaine confusion. Mais à mesure que les mots se déposent, la sensation devient phrase, puis signification. Ce qui était vécu uniquement dans la matière commence à exister dans le langage. C’est ainsi que le corps cesse d’être agissant pour devenir signifiant.
Winnicott parlait de l’aire transitionnelle : cet espace où la réalité intérieure rencontre la réalité extérieure, et où le jeu, le dessin ou l’écriture permettent de penser sans être envahi. Écrire le corps, c’est créer cette aire de passage entre la sensation et la parole, pour que ce qui a été subi puisse devenir symbolisé.

Le corps comme archive du trauma
Certains vécus s’impriment dans le corps sans jamais accéder au langage. Quand la douleur est trop intense, la psyché se retire et laisse le corps faire face.
La mémoire traumatique n’est pas un souvenir ordinaire : c’est une trace figée, logée dans la sensation. Le corps, alors, devient l’archive du trauma.
Freud parlait de réminiscences corporelles, ces retours du refoulé sous forme de symptômes ; aujourd’hui encore, de nombreux cliniciens observent comment les traumas précoces s’expriment par le corps avant de pouvoir être mis en mots.
Dans l’écriture, cela se manifeste souvent par des images récurrentes : le froid, la coupure, la brûlure, le silence. Ces images traduisent une tentative de symbolisation.
Écrire le trauma corporel, ce n’est pas tout dire, c’est créer un espace de transformation : permettre à la mémoire figée de trouver une forme fluide. Parfois, une phrase suffit pour qu’un souvenir silencieux trouve enfin une représentation. C’est là que l’écriture rejoint le soin : elle ne guérit pas, mais elle ouvre un passage.
Trois manières d’écrire le corps
On peut distinguer trois approches, souvent entremêlées, mais chacune éclaire un aspect du travail d’écriture :
1. Écrire le corps.
Le corps devient sujet : on le décrit, on l’écoute, on le laisse exister dans la phrase. Cette écriture explore la sensation présente, la relation au monde, l’expérience incarnée.
2. Écrire à partir du corps.
L’écriture part d’une perception ou d’un mouvement – une respiration, un frisson, une tension – pour remonter vers une émotion, une histoire, un sens. C’est la voie de la symbolisation : le corps ouvre l’accès à la mémoire.
3. Écrire sur le corps.
Ici, le regard se fait plus distancié : on réfléchit au corps comme thème, comme représentation sociale, culturelle ou psychique. C’est une écriture de pensée, qui prolonge la clinique dans la réflexion.
Ces trois formes ne s’opposent pas ; elles dessinent une progression : du ressenti immédiat à la conscience, puis à la mise en sens. Chaque étape déplace le rapport au corps : d’objet vécu à partenaire de langage.
Le corps comme outil de transformation
Quand on écrit le corps, il ne s’agit pas seulement de le représenter, mais de le transformer. Ce mouvement est souvent imperceptible : une sensation qui s’apaise, une respiration qui se régularise, un souvenir qui cesse de serrer. Ce n’est pas la magie de l’écriture, mais le signe qu’une symbolisation a eu lieu. Le corps n’a plus besoin d’agir, puisqu’il a été entendu.
L’écriture crée cette circulation entre le psychique et le somatique. Elle met du lien là où il y avait coupure. Elle permet de se réapproprier le corps, non comme un objet à maîtriser, mais comme une partie pensante de soi. On ne sort pas indemne de ce travail : quelque chose bouge, parfois lentement, parfois avec intensité. Mais ce mouvement est vital : il rend au sujet la possibilité d’habiter pleinement son expérience, sans la subir.
Du corps au sujet

Écrire le corps, ce n’est pas se centrer sur soi, c’est se relier à ce qui, en soi, reste sans langage. Ce corps qui agit, qui se tend, qui s’épuise ou qui désire, c’est lui le premier interlocuteur. Le reconnaître, c’est se réconcilier avec la part la plus concrète et la plus fidèle de notre histoire.
À mesure que le texte se tisse, une transformation subtile se produit : le corps cesse d’être perçu comme un objet à soigner ou à maîtriser. Il devient un partenaire de sens, une instance vivante du récit. Ce n’est plus le corps qui subit ou qui parle à travers les symptômes, mais le sujet qui parle avec son corps. Le passage du geste au mot, de la douleur à la pensée, constitue ce mouvement de subjectivation si central dans le travail d’écriture thérapeutique.
✍️ Consigne Psychoplume
Dans ton carnet, choisis une sensation corporelle du moment. Ne cherche pas son origine : décris-la simplement, avec ses contours, son intensité, son rythme. Puis laisse venir les images, les souvenirs ou les mots qui s’y associent. Continue à écrire jusqu’à sentir que la sensation s’est transformée, que quelque chose a bougé en toi.
Relis ensuite ton texte.
Que s’est-il passé entre la première ligne et la dernière ?
La sensation est-elle restée la même ou a-t-elle trouvé un autre langage ?
Ce passage, de la chair au signe, du ressenti au récit, constitue le cœur du travail d’écriture du corps.
Conclusion : le corps, premier et dernier récit
Nous commençons nos vies dans un corps, et nous les racontons à travers lui. Entre les deux, l’écriture fait le lien : elle permet de transformer les traces muettes en signes, les sensations en pensée, la douleur en savoir.
Le corps est notre premier texte : il porte, avant les mots, la grammaire de notre histoire. Écrire le corps, c’est en quelque sorte traduire ce manuscrit originel, page après page, jusqu’à ce qu’il redevienne lisible.
Et dans cette relecture, quelque chose s’apaise : on comprend que ce qui faisait souffrance n’était pas seulement la blessure, mais le silence qui l’entourait.
Écrire, c’est redonner la parole à ce silence.
C’est reconnaître, enfin, que le corps et la parole appartiennent à la même langue.
🌱 Pour aller plus loin avec ton écriture
Si tu veux explorer plus profondément ce lien entre corps, émotions et écriture, le programme Plumes thérapeutiques te guide dans une exploration psychologique par l’écriture.
C’est un parcours qui t’accompagne pas à pas pour comprendre ce que ton corps écrit avant toi, et comment transformer ces traces en langage, en sens, en mouvement intérieur.
En savoir plus sur Psycho-Plume
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






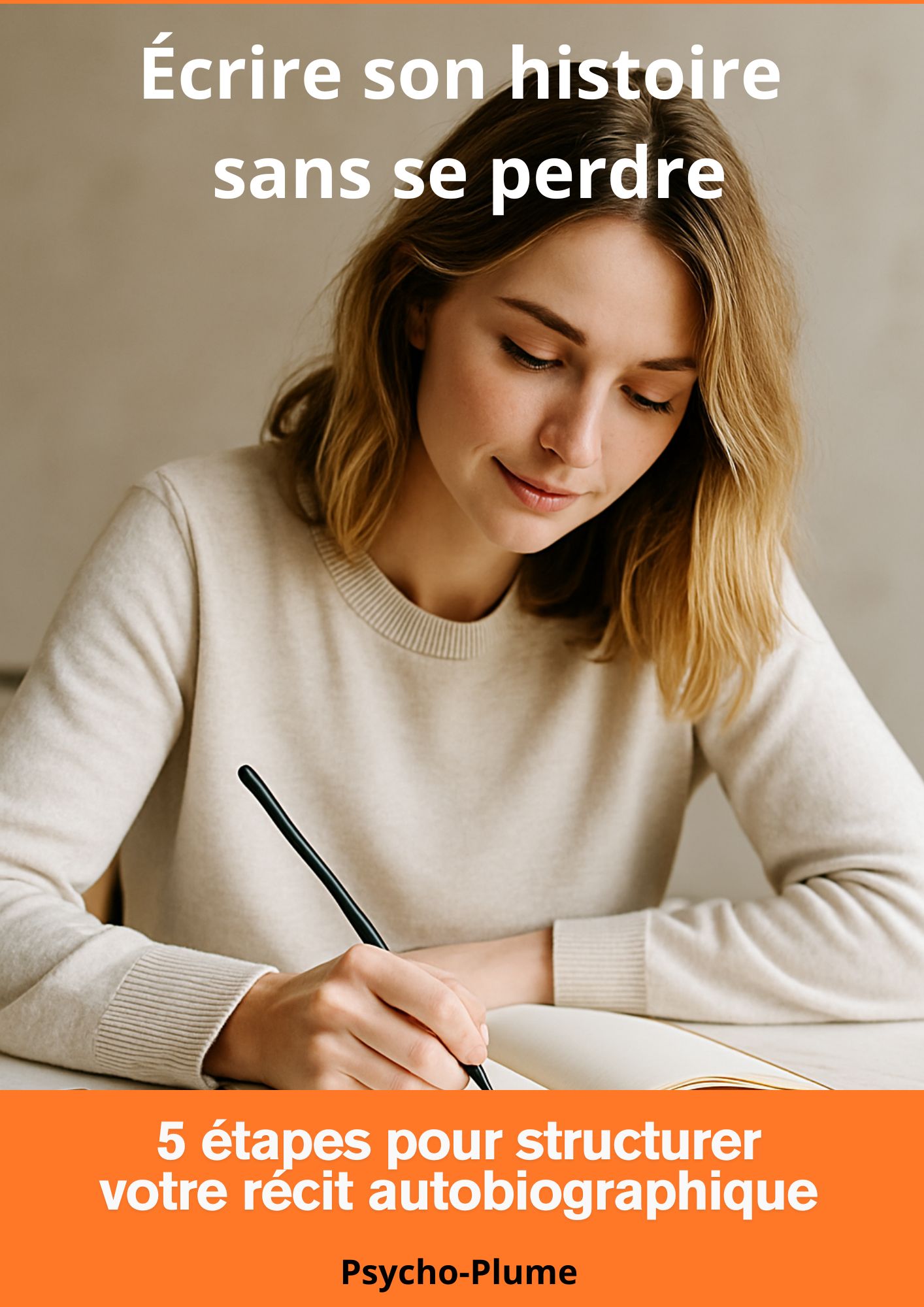
4 commentaires
exactlysuccessful25b578f9e5
Chère Olivia , je vous prie de m’excuser, mais je ne me sens pas en état de poursuivre l’avancée des présentiels sur l’écriture dans Psychoplumes . Trop troublant, trop déstabilisant pour moi actuellement . Pas de trauma particulier, pas de viol, pas d’horreur, du tout . Juste en deuil récent de mon père et je viens tout juste d’en finir avec le fait de tout faire disparaitre de chez lui, pour vendre son appartement. Alors, les objets chers, m’en séparer par centaines m’a complètement brisé le coeur . Je viens juste de finir il y a 3 mois . Je l’ai épaulé 7 ans, au quotidien, et je viens de donner en plus un an et demi à achever la succession . J’ai plus besoin d’apaisement que de me retourner les sens avec les objets, etc, les images du passé qui ne m’ont pas quittées un seul jour depuis un an et demi . Je suis désolée . J’ai vu les videos, le cursus, et cela m’a certes permis d’avancer . Je vous remercie pour votre travail et pour votre aide . Je n’ai pas l’intention d’écrire mon autobiographie . Je tiens à vous remercier très sincèrement pour ce parcours qui m’a permis d’avancer . Je termine bientot la lecture d’Anouk, que j’adore, et je lirai très certainement votre dernier roman Psychotherapeute . Avec grand plaisir . Bien amicalement . Marie-Dominique .
Olivia
Merci beaucoup, Marie-Dominique, pour tes mots et pour la sincérité de ton partage 🌿
Ton message reflète bien ce que j’espère transmettre à travers Plumes Thérapeutiques : un espace d’écriture qui permet d’avancer à son rythme, d’explorer, de se découvrir, puis parfois de faire une pause quand c’est le moment juste.
Je suis très touchée que le parcours t’ait accompagnée un temps, et heureuse de savoir qu’il a pu t’aider à cheminer avec douceur. 💜
Flore du Web
Merci Olivia d’ouvrir ce sujet. J’avoue n’avoir jamais pensé à écrire sur le corps ou els souvenirs qui y sont liés, mais c’est une excellente idée.
Eva
Dans la recherche de mon style d’écriture, je suis consciente de l’importance de mobiliser tous les sens pour transmettre des émotions, mais ça reste souvent théorique. Je suis très heureuse de trouver dans ton article les leviers pour écrire à partir du corps (et non d’un champ sémantique figé).
L’image de l’écriture comme passerelle entre le psychique et le somatique est très belle, très féconde.
Merci.