
Écrire quand on ne va pas bien : faut-il forcer ou attendre ?
Il y a des jours où la page nous fait peur. Des heures où l’on sent l’écriture tout près, presque au bord des lèvres — mais rien ne vient. Ou alors, ce qui vient semble trop lourd, trop fragile, ou trop confus pour être couché noir sur blanc. Faut-il forcer l’écriture, comme on se pousserait à sortir marcher sous la pluie ? Ou faut-il, au contraire, attendre que l’élan revienne de lui-même, comme une marée discrète qui finirait par recouvrir le sable sec ?
La question n’est pas nouvelle. Derrière cette hésitation — écrire ou ne pas écrire — se joue un rapport intime à soi, à la douleur, à l’élan vital. Une manière d’habiter le silence. Et une forme de soin.
Ce qui se joue quand l’écriture s’arrête
Quand on ne va pas bien, écrire semble à la fois urgent et impossible. Comme si deux forces contraires tiraient en nous : d’un côté, l’envie de déposer, de poser des mots là où ça brûle ; de l’autre, une résistance sourde, un engourdissement. Le vide.
Il ne s’agit pas d’un simple manque d’inspiration. Ce qui fige, dans ces moments-là, n’est pas le style, ni la technique. C’est la peur d’ouvrir une brèche. De faire surgir ce qu’on ne maîtrise plus. L’écriture devient une porte qu’on redoute d’ouvrir, car on ne sait pas ce qui va en sortir. Des larmes, peut-être. Une colère refoulée. Un souvenir qu’on croyait éteint. Ou simplement un grand désordre.
La tentation est alors forte de se taire. D’attendre que ça passe. Que l’on aille mieux. Que les idées s’ordonnent. Pourtant, ce silence n’est pas toujours reposant. Il peut devenir pesant, étouffant. Comme un mot retenu trop longtemps au fond de la gorge.
Certaines personnes s’obligent à écrire, convaincues que cela leur fera du bien. D’autres s’en veulent de ne pas y arriver, et ajoutent au mal-être initial une couche de culpabilité. Et parfois, on finit par croire que ce n’est pas le moment. Que ce n’est jamais le bon moment.
Mais s’agit-il vraiment de choisir entre forcer ou attendre ?
Ce qu’écrire veut dire quand le cœur est encombré
Il est important de différencier plusieurs types de silence.
Il y a le silence de l’écoute, fertile, qui précède l’écriture — ce silence-là est plein. Il prépare quelque chose.
Et puis il y a le silence du figement, celui du repli, du retrait, de l’angoisse. Celui-là n’est pas toujours choisi. Il s’impose, comme un voile.
Quand on ne va pas bien, notre système nerveux est souvent en état d’alerte : submergé, en vigilance, ou figé. Dans ces états, l’accès aux fonctions créatives est limité. Ce n’est pas une question de volonté. C’est biologique. Notre cerveau limbique prend le dessus : il priorise la survie, pas la narration.
Autrement dit : si tu n’arrives pas à écrire, ce n’est pas parce que tu manques de discipline. C’est peut-être simplement parce que ton corps ne peut pas — pas encore. Il a besoin d’apaisement avant d’accéder à la mise en récit.
Vouloir « forcer » dans ces états-là revient à se faire violence. Mais cela ne veut pas dire qu’il faille attendre passivement que l’inspiration revienne. Il existe un entre-deux, plus doux, plus respectueux du vivant.
Écrire autrement : les formes lentes, flottantes, latentes

Quand l’écriture frontale est trop difficile — écrire « je souffre », « j’ai peur », « je suis perdue » — il est possible d’écrire de biais. Par glissements. Par fragments. Par images.
Tu peux, par exemple :
- écrire une liste de sensations dans ton corps
- décrire une image qui te hante (un rêve, un souvenir flou, un lieu)
- noter une phrase que tu entends en boucle dans ta tête
- inventer une métaphore de ton état intérieur (« aujourd’hui, je suis un coquillage vide »)
- dialoguer avec une partie de toi (la peur, la colère, la lassitude…)
Ces formes d’écriture ne visent pas la clarté. Elles ne cherchent pas à expliquer. Elles accompagnent. Elles accueillent ce qui se présente sans chercher à tout comprendre.
Parfois, écrire ainsi, par fragments, permet justement à la pensée de se réorganiser. L’écriture vient alors non pas parce qu’on va mieux, mais pour faire un peu de place à ce qu’on traverse.
Le seuil : écrire oui, mais à quel prix ?
Dans mon accompagnement, je parle souvent du « seuil d’écriture » : cette frontière invisible entre ce qui est soutenable et ce qui ne l’est pas. Elle varie selon les jours, les heures, les vécus. Il n’y a pas de règle fixe.
Certaines personnes peuvent écrire des pages entières après un choc ou une crise. D’autres ont besoin de plusieurs jours, semaines, voire années, pour poser ne serait-ce qu’un mot. Tout est juste.
Ce qui compte, c’est d’écouter ce que ton écriture te demande. Est-ce qu’elle vient avec une sensation d’apaisement ? Est-ce qu’elle ouvre quelque chose ? Ou bien est-ce qu’elle te laisse plus fragile qu’avant ? Est-ce qu’elle réactive une douleur ? T’épuise ? Te vide ?
Ce n’est pas l’acte d’écrire en soi qui est bon ou mauvais : c’est ce qu’il provoque en toi. Et cette réponse est unique, mouvante, intime.
Le bon moment pour écrire n’est pas celui que les autres désignent. C’est celui où tu peux le faire sans te perdre.
Entre soin et performance : dénouer les attentes
Une autre difficulté fréquente tient à ce que l’on attend de l’écriture.
On imagine souvent qu’écrire devrait soulager, apaiser, guérir. Et quand ce n’est pas le cas — quand l’écriture ravive une douleur ou laisse un goût d’inachevé — on s’inquiète. On pense qu’on s’est trompé·e. Ou qu’on n’est pas capable.
Mais l’écriture n’a pas de promesse unique. Parfois, elle soulage. Parfois, elle éclaire. Parfois, elle trouble. C’est une traversée, pas un médicament. Elle ne fonctionne pas à dose fixe, ni à efficacité constante.
Sortir de l’attente permet souvent de relâcher la pression : écrire pour écrire. Pas pour produire un beau texte. Pas pour aller mieux tout de suite. Juste pour rester en lien. Pour se déposer quelque part.
Petites écritures de brouillard : 5 gestes simples

Voici quelques pratiques douces à essayer dans les jours sans :
- L’écriture-chronomètre
→ Mets un minuteur de 5 minutes. Écris sans t’arrêter. Même si c’est « je ne sais pas quoi écrire ». Cela peut relancer le fil. Mais dès que tu ressens une tension, tu arrêtes. - Le mot-miroir
→ Choisis un mot qui résonne avec ton état (fatigue, colère, froid, silence…). Note tout ce qu’il t’évoque : images, souvenirs, phrases, couleurs, sensations. - Le carnet sensoriel
→ Note ce que tu ressens dans ton corps, dans tes mains, dans ton ventre. La météo autour de toi. Les sons, les odeurs. Ancre-toi dans le réel. - Le fragment du jour
→ Chaque soir, une phrase. Juste une. Pas plus. Une sensation, un souvenir, un mot entendu. Ce n’est pas un texte, c’est une trace. - La lettre qui ne sera pas envoyée
→ Écris à quelqu’un — vivant ou non, réel ou imaginaire. Tu n’as pas besoin d’expliquer. Tu peux même n’écrire qu’un mot.
Ces pratiques sont là comme des points d’appui, pas des obligations. Elles peuvent être suspendues, reprises, modifiées.
À chaque heure sa plume : écrire le matin, en journée, le soir, la nuit
Notre rapport à l’écriture change selon l’heure. Ce n’est pas une question d’emploi du temps, mais de tonalité intérieure. Chaque moment de la journée porte une lumière particulière, une respiration propre — et cette atmosphère colore ce que l’on écrit.
Le matin : la page encore vierge
Le matin est un temps propice à l’écriture instinctive, brute, encore non traversée par les contraintes du jour. C’est le moment du flux, avant que les pensées ne s’organisent. On peut y pratiquer :
- l’écriture automatique
- le journal de bord
- les intentions, les questions ouvertes
Le matin est un temps de jaillissement. On ne cherche pas à comprendre, on écrit pour sentir.
En journée : l’écriture cadrée
Le jour, plus mental, offre un terrain favorable à la structuration. C’est l’heure de :
- relire, retravailler
- ordonner les idées
- écrire un texte plus construit
- réfléchir à un projet
C’est une écriture plus consciente, plus exigeante, parfois plus critique. Elle permet d’avancer.
Le soir : l’écriture de l’intime
Le soir dépose la fatigue et les émotions accumulées. Il appelle :
- les bilans sensibles
- les lettres à soi
- les mots murmurés dans un carnet
- une écriture d’apaisement ou de désencombrement
Elle ne cherche pas à convaincre, seulement à déposer.
La nuit : l’écriture en seuil
La nuit est le territoire des surgissements. C’est le moment où :
- l’inconscient affleure
- la censure baisse
- des images viennent, insaisissables mais précieuses
Écriture de veille, d’intuition, de traversée. À manier avec douceur.
Et si ne pas écrire était aussi un acte d’écriture ?
Il y a une écriture silencieuse. Celle qui se prépare à l’intérieur. Celle qui germe sans faire de bruit. Parfois, on croit qu’on ne fait rien, mais quelque chose travaille. Le silence n’est pas toujours vide. Il est peut-être l’endroit où ton texte futur se forme, lentement.
Tu n’as pas à justifier ce temps-là. Il fait partie du processus. Ne pas écrire, ce n’est pas forcément renoncer. C’est parfois mûrir. Rassembler. Se soigner d’abord.
La terre en jachère n’est pas une terre morte. Elle se régénère.
Conclusion : un choix vivant, pas un dilemme
Alors, faut-il forcer ou attendre ?
Ni l’un, ni l’autre. Ou les deux, à des moments différents.
Il ne s’agit pas d’une injonction à écrire malgré tout, ni d’un abandon de l’écriture en temps difficile. Il s’agit d’habiter la nuance. D’inventer un rapport vivant à la plume. Un rapport qui te respecte, qui t’écoute, qui ne cherche pas à t’imposer un rythme qui n’est pas le tien.
Tu peux écrire autrement. Tu peux écrire peu. Tu peux écrire lentement. Tu peux écrire sans but.
Et tu peux aussi ne pas écrire, et revenir un jour.
Car l’écriture, quand elle est vivante, ne nous quitte jamais vraiment. Elle attend. Et elle revient, dès qu’on lui rouvre la porte.
✍️ Si tu ressens le besoin d’être accompagnée dans ce chemin d’écriture intérieure,
mon programme Plumes Thérapeutiques est fait pour toi.
C’est un espace progressif, sans pression, où chaque mot peut trouver sa place.
En savoir plus sur Psycho-Plume
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






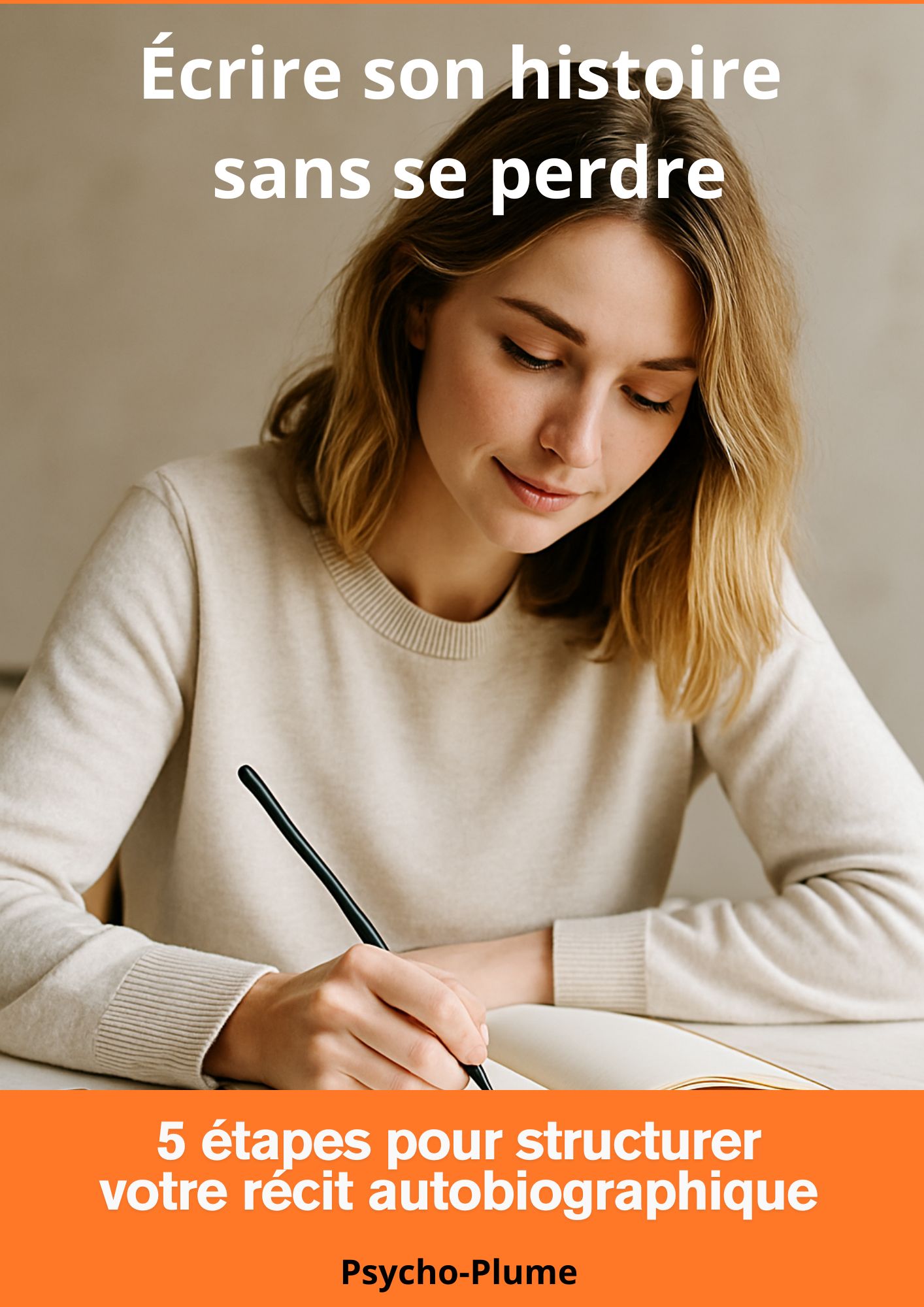
Un commentaire
Pauline
En résumé, il faut écouter son corps et ses émotions. Merci pour ces précieux conseils qui déculpabilisent quand on ne ressent tout simplement plus l’envie d’écrire.