
Autobiographie et mémoire : réveiller ses souvenirs avec des outils concrets
Écrire son autobiographie n’est pas seulement une affaire de style ou de structure. C’est avant tout un travail de mémoire. Pourtant, bien des personnes qui souhaitent se lancer dans ce projet se heurtent rapidement à un obstacle : comment retrouver ses souvenirs ?
La mémoire semble capricieuse. Certains épisodes ressurgissent avec une précision troublante, tandis que d’autres demeurent flous, voire inaccessibles. On se souvient d’un visage mais pas d’un nom, d’un parfum mais pas du lieu, d’une émotion mais pas de l’événement qui l’a déclenchée.
Cet article explore la question de la mémoire en autobiographie. Comment réveiller les souvenirs ? Quels outils symboliques et sensoriels peuvent accompagner ce travail ? Et en quoi ces techniques nourrissent-elles une écriture introspective fidèle à l’esprit Psycho-Plume ?
La mémoire autobiographique : un trésor partiel et sélectif
La mémoire n’est jamais un enregistrement neutre. Elle sélectionne, déforme, amplifie, oublie. Ce qui reste en nous n’est pas seulement le fait brut, mais la trace émotionnelle qu’il a laissée.
- Sélective : on garde davantage ce qui nous a marqués affectivement.
- Fragmentée : les souvenirs se présentent sous forme d’images isolées, de sensations, de scènes incomplètes.
- Évolutive : un souvenir peut changer en fonction du moment de vie où l’on le convoque.
Ainsi, écrire son autobiographie ne signifie pas “rétablir la vérité historique” mais reconstruire un récit à partir de la matière mémorielle disponible.
Le travail consiste donc à élargir l’accès à cette matière : réveiller les souvenirs endormis, retrouver des fragments, les associer, et leur donner une forme.
Réveiller ses souvenirs grâce aux déclencheurs sensoriels

Nos souvenirs sont souvent liés à des sensations corporelles. Les odeurs, les sons, les textures, les goûts ou les images déclenchent une réminiscence plus sûre que les simples efforts de volonté.
Les odeurs
Une odeur de café peut ramener à la cuisine d’un grand-parent, une fragrance de savon à l’enfance. Le pouvoir évocateur des odeurs tient à leur lien direct avec le système limbique, siège des émotions et de la mémoire.
Exercice autobiographique : choisis trois odeurs (café, lessive, parfum) et écris ce qu’elles font surgir. Même si ce n’est qu’une image fugace, note-la. Souvent, d’autres souvenirs suivent.
Les sons et la musique
Une chanson entendue à la radio peut ressusciter une époque entière. La mémoire auditive agit comme une capsule temporelle.
Exercice autobiographique : crée une playlist de dix chansons marquantes pour toi. Écoute-les et décris à chaque fois où elles te transportent. Pour aller plus loin, imagine une scène où deux personnages entendent la même chanson mais n’en retiennent pas la même chose.
Les objets
Un objet conservé – bijou, vêtement, carnet – agit comme une clé de mémoire. Il condense un moment, un lien, une histoire.
Exercice autobiographique : prends un objet de ton enfance et décris-le avec minutie. Ensuite, laisse venir l’histoire qu’il raconte. Tu peux aussi comparer ce que représente cet objet pour toi et ce qu’il représenterait pour un inconnu qui le découvrirait.
Les lieux
Revenir dans une maison, une école, une rue, déclenche des réminiscences précises. Même sans se déplacer, regarder des photos de lieux peut suffire à réveiller la mémoire.
La puissance des supports visuels
Les photos sont de formidables déclencheurs. Mais il ne s’agit pas seulement de les décrire : il faut écouter ce qu’elles ne montrent pas.
- Qui manque sur la photo ?
- Que ressentais-tu à ce moment-là ?
- Quelle ambiance n’apparaît pas mais que tu connais intérieurement ?
Exercice autobiographique : prends une photo de famille. Note d’abord ce que tu vois objectivement (les personnes, le décor). Puis écris un second texte en racontant ce qui n’est pas visible (les tensions, les joies, les secrets). Tu peux ensuite imaginer une troisième version, fictive, où tu modifies un détail de la photo : que se passerait-il si quelqu’un d’absent y figurait ?
Mémoire corporelle et gestes quotidiens

Le corps est un immense réservoir de mémoire. Certains gestes automatiques réveillent des souvenirs : éplucher une pomme peut ramener aux goûters de l’école, marcher sur un sol pavé évoquer une ville précise.
Exercice autobiographique : choisis un geste quotidien (faire du café, nouer une écharpe). Décris-le en détail, puis interroge-toi : Quand ai-je fait ce geste pour la première fois ? Avec qui ? Dans quel contexte ?
L’écriture comme outil de remémoration
L’acte d’écrire lui-même stimule la mémoire. Une phrase en appelle une autre.
- Écriture libre : poser les mots sans réfléchir. Le souvenir se fraye souvent un chemin par association.
- Listes : écrire une liste de maisons habitées, de prénoms de proches, de métiers exercés. Chaque item peut devenir une porte.
- Cartographie : dessiner un plan de ton quartier d’enfance et noter les histoires liées à chaque lieu.
Ces méthodes concrètes ouvrent des passages vers une mémoire qui semblait verrouillée.
Mémoire émotionnelle : quand les affects guident les souvenirs
On croit souvent que les souvenirs sont purement visuels ou factuels. Mais en réalité, ce sont les émotions qui les colorent et leur donnent une intensité particulière.
- Un épisode banal peut devenir inoubliable parce qu’il fut associé à la honte, à la peur ou à la joie.
- À l’inverse, certains souvenirs douloureux peuvent être refoulés et difficiles à retrouver.
Exercice autobiographique : note trois émotions fortes de ta vie (ex. colère, émerveillement, solitude). Pour chacune, écris un souvenir précis où tu l’as ressentie pour la première fois.
Mémoire familiale et transmissions
Nos souvenirs ne sont pas isolés. Ils s’inscrivent dans une mémoire transmise par la famille.
- Les récits entendus à table deviennent parfois des “souvenirs adoptés”.
- Les archives familiales (lettres, journaux, photos anciennes) servent de relais entre générations.
- Les silences et les tabous sont eux aussi des héritages : ce qui n’a pas été dit fait partie de la mémoire familiale.
Exercice autobiographique : interroge un proche sur un épisode de ta vie dont tu ne te souviens pas. Compare son récit au tien et note les écarts.
Symboles et archétypes : mémoire imaginaire

La mémoire n’est pas seulement factuelle. Certains souvenirs sont liés à des images symboliques.
- Une forêt peut représenter le sentiment d’isolement vécu dans l’enfance.
- Un animal peut cristalliser la peur ou la protection.
- Un objet rêvé peut renvoyer à un épisode réel enfoui.
Exercice autobiographique : ferme les yeux et visualise un lieu récurrent de tes rêves. Note ce qu’il évoque et relie-le à une période de ta vie.
Mémoire et imagination : combler les blancs
Quand un souvenir manque, l’imagination prend parfois le relais. Loin d’être une trahison, elle peut être une alliée.
- Elle permet de reconstruire une scène à partir de fragments.
- Elle aide à explorer des hypothèses : que se serait-il passé si… ?
- Elle donne accès à une vérité émotionnelle, même si le détail factuel est incertain.
Dans une autobiographie, il est possible de signaler cette part d’imaginaire : écrire « je ne sais plus si… », ou « peut-être que… ». Ces formules respectent la sincérité tout en ouvrant un espace créatif.
Exercice autobiographique : choisis un souvenir dont il te manque un détail (un lieu, un prénom, une date). Écris deux versions : l’une avec ce que tu sais, l’autre en laissant libre cours à ton imagination pour compléter les vides.
Mémoire blessée : trous et silences
Certains souvenirs sont difficiles d’accès car liés à des événements traumatiques. La mémoire peut alors :
- se fragmenter : images éclatées, impressions incomplètes ;
- se protéger : oubli volontaire ou involontaire, refoulement ;
- se transformer : récit réinterprété pour le rendre supportable.
Écrire ne doit pas forcer ces souvenirs, mais permettre de les approcher doucement. Les blancs et les silences font aussi partie de l’autobiographie.
Les déclencheurs collectifs : histoire et culture
Parfois, on retrouve sa propre mémoire en la confrontant à celle des autres.
- Lire des journaux ou des publicités d’une époque réveille des atmosphères.
- Revoir des films ou des séries anciennes déclenche une mémoire affective.
- Échanger avec un proche qui a vécu les mêmes scènes permet de compléter ses propres lacunes.
Exercice autobiographique : prends une année marquante (ex. 1989, 2001). Recherche trois événements historiques ou culturels de cette année. Écris ce que tu faisais à ce moment-là.
Les pièges de la mémoire autobiographique
Réveiller ses souvenirs n’est pas sans écueils :
- Confondre souvenirs et reconstructions : un récit de famille répété peut devenir un faux souvenir.
- Se laisser piéger par l’idéalisation : certaines images sont embellies ou dramatisées par le temps.
- Vouloir tout retrouver : il restera toujours des trous, et c’est normal.
Accepter que la mémoire est subjective est essentiel. L’autobiographie ne cherche pas la vérité absolue mais une vérité personnelle et incarnée.
Témoignages d’auteurs : mémoire et création

- Marcel Proust (À la recherche du temps perdu) : l’épisode de la madeleine illustre le lien entre goût et mémoire involontaire.
- Georges Perec (Je me souviens) : un inventaire de souvenirs collectifs et personnels, preuve que la mémoire se nourrit de détails.
- Nathalie Sarraute (Enfance) : dialogues avec elle-même pour vérifier la fiabilité de ses souvenirs.
- Simone de Beauvoir (Mémoires d’une jeune fille rangée) : récit qui mêle souvenirs personnels et contexte culturel.
- Annie Ernaux (Les Années) : une mémoire à la fois intime et collective, portée par l’histoire d’une génération.
Ces auteurs montrent que la mémoire n’est jamais simple restitution, mais matière créatrice.
Conseils pratiques pour stimuler sa mémoire autobiographique
- Créer un rituel : écrire toujours au même endroit, à la même heure, pour laisser la mémoire s’ouvrir.
- Tenir un carnet de réminiscences : noter chaque image, même fugitive, pour la retravailler plus tard.
- Alterner recherche et lâcher-prise : chercher un souvenir précis, puis laisser venir d’autres associations.
- Accepter l’incomplétude : un trou de mémoire peut devenir un thème d’écriture en soi.
- Varier les déclencheurs : ne pas se limiter aux photos, mais explorer sons, odeurs, objets, lieux.
L’effet thérapeutique de la remémoration
Réveiller ses souvenirs n’est pas un simple exercice technique. C’est une rencontre avec soi-même.
- Mettre en mots apaise certaines blessures.
- Relier les fragments donne un sentiment de continuité.
- Transformer les images intérieures en récit crée une distance libératrice.
Ce travail correspond pleinement à l’esprit Psycho-Plume : écrire pour mieux se comprendre, se réconcilier avec son histoire et transmettre.
Après l’écriture : partager et transmettre
Une fois les souvenirs réveillés et transformés en textes, se pose la question de leur devenir.
- Partage intime : offrir son récit à quelques proches, comme un cadeau de mémoire.
- Transmission familiale : conserver ses textes dans un cahier, une boîte, un document numérique, pour les générations futures.
- Publication : envisager l’édition ou l’autoédition, pour donner une portée plus large à son expérience.
Quel que soit le choix, l’essentiel est que ces récits trouvent un lieu où vivre, au-delà du simple carnet.
Conclusion : écrire avec la mémoire vivante
Écrire son autobiographie, ce n’est pas restituer une chronologie parfaite, mais donner une voix à la mémoire vivante. Les souvenirs ne sont pas toujours disponibles, mais ils peuvent être réveillés grâce aux déclencheurs sensoriels, symboliques et culturels.
Chaque odeur, chaque objet, chaque photo devient une porte ouverte sur soi. L’écriture ne se contente pas de consigner : elle stimule, transforme et relie.
En t’appuyant sur ces outils, tu découvriras que ta mémoire est plus riche que tu ne le crois. Même ses manques, ses silences et ses déformations peuvent devenir des matières précieuses pour ton autobiographie.
👉 Si tu veux aller plus loin, être guidé pas à pas et trouver la forme juste pour ton récit, je t’accompagne dans la formation Plumes Autobiographiques. Tu y trouveras une méthode claire, des exercices concrets et un cadre bienveillant pour transformer tes souvenirs en un texte cohérent et porteur de sens.
Découvrir la formation ici : Plumes Autobiographiques
En savoir plus sur Psycho-Plume
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






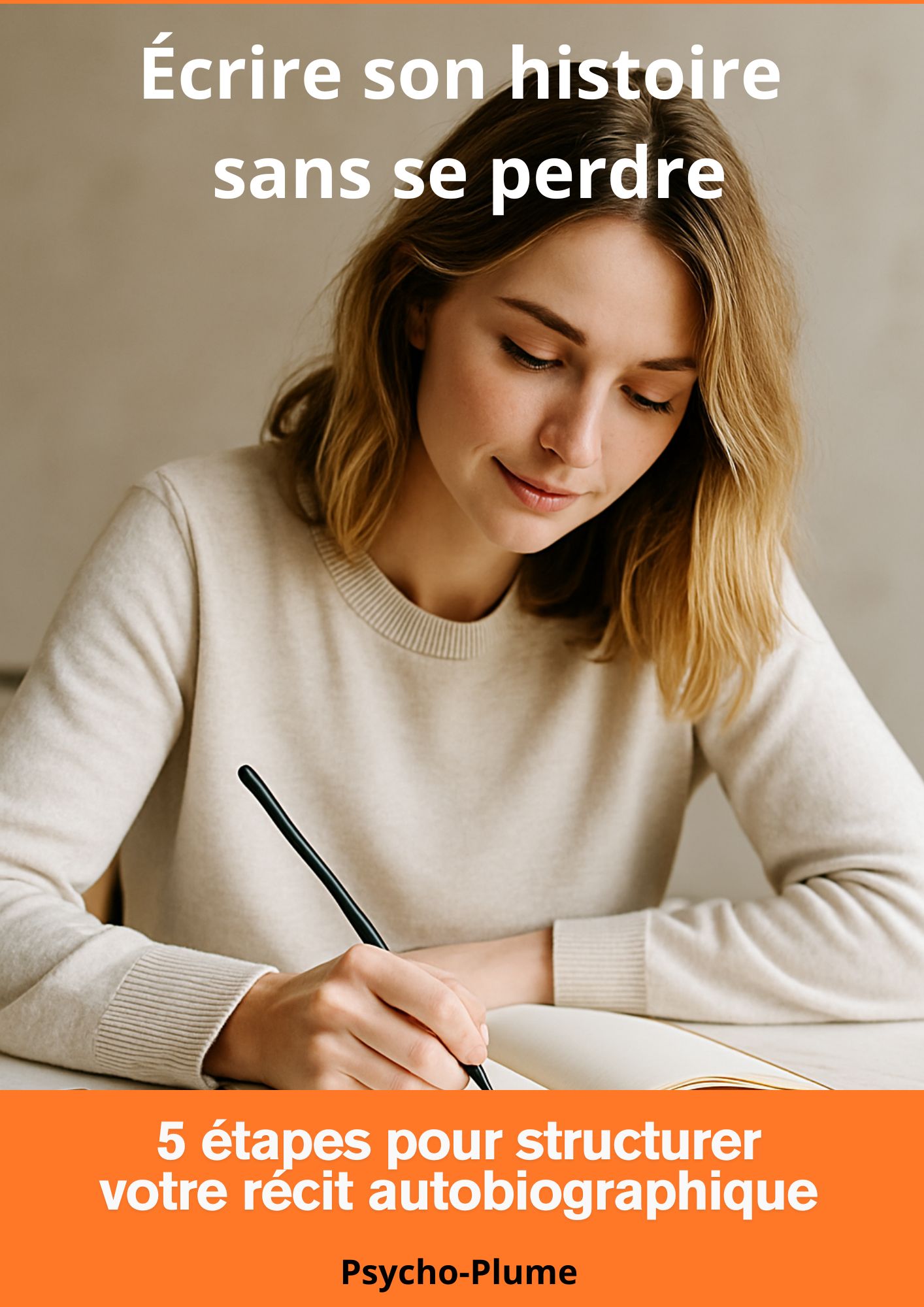
2 commentaires
noirenvoyage
Merci pour cet article qui mêle avec tant de justesse l’intime et le pratique. En voyage, j’encourage souvent à tenir un carnet, non pas pour “raconter” mais pour réveiller ce qui dort en nous. Ton approche, en douceur, en reliance avec les sensations, est précieuse : c’est exactement ce qu’il faut pour initier un dialogue avec sa mémoire.
Fabienne - AnimaSoins au Naturel
Merci Olivier 👏 pour ton superbe article qui rappelle combien « Le corps est un immense réservoir de mémoire » comme tu nous le rappelles. Mémoire émotionnelle et exercices d’écriture vraiment inspirants. J’ai pris le temps d’en pratiquer certains : la soupe aux légumes, par exemple, m’a ouvert une véritable porte de souvenirs – une évocation simple mais tellement chargée en émotions, en images et pour une période bien précise.
Merci de nous transmettre tes passions et de nous donner envie d’écrire autrement et d’explorer notre mémoire sous un autre angle. 🌿✍️